Une Allemagne secouée par des attentats en 2025, où Angela Merkel a quitté le pouvoir sous les huées, où un parti nationaliste est arrivé aux affaires ; une Allemagne dont les citoyens boudent les urnes. Une Allemagne où le pouvoir ne pense plus qu’à faire adopter des « packs d’efficience ». C’est celle de Cœurs vides (Actes Sud), roman de Juli Zeh, écrivaine à succès outre-Rhin, qui met en scène la crise profonde de nos démocraties et désigne un responsable. Le futur proche a la cote en littérature depuis quelques années. La Néerlandaise Anna Enquist nous a projetés, avec Quatuor, dans un monde où le pouvoir jugeait la culture inutile et soumettait tout au principe de rentabilité ; Boualem Sansal s’est aventuré en 2084 ; Michel Houellebecq, après Soumission, qui prédisait la victoire d’un parti musulman en France, récidive cette année avec Anéantir, en s’installant en 2027. Juli Zeh, née en 1974 à Bonn, n’est pas en reste. En 2009, avec Corpus Delicti – Un procès (Actes Sud), elle imaginait une société soumise en 2057 à une dictature sanitaire où les humains poussent à l’extrême leurs penchants à l’optimisation et où la maladie passe pour un dysfonctionnement, un échec. La revoici maintenant, avec Cœurs vides, dans une Allemagne bien plus proche de nous, dans trois ans, mais il faut avoir à l’esprit que le roman a été publié en 2017, alors que Merkel était encore chancelière, alors que l’accueil de centaines de milliers de réfugiés en Allemagne, deux ans plus tôt, provoquait par contrecoup une montée…
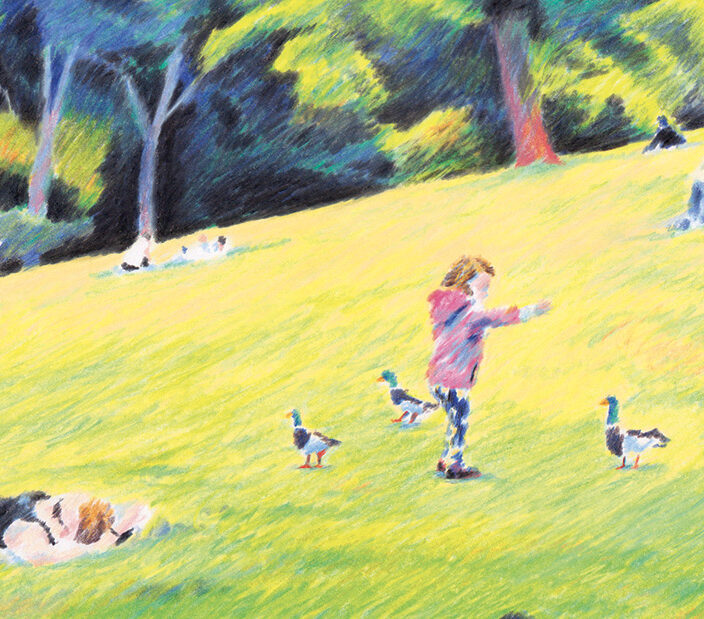
Algorythme d’enfer
Éric Faye



