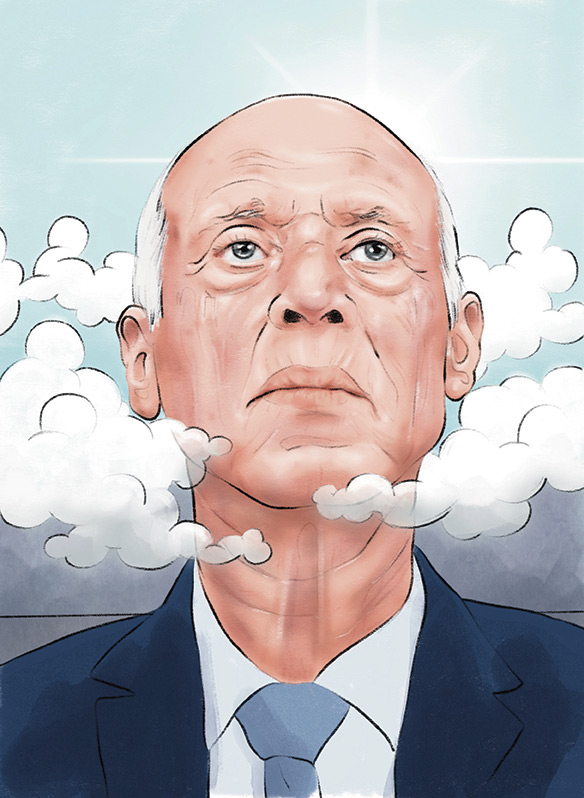kaïs saïed, ou le coup d’État permanent
Modeste, longtemps obscur, Kaïs Saïed a créé la surprise en remportant largement la dernière présidentielle tunisienne, en 2019. Depuis cette victoire incontestée, il ne cesse de brutaliser la Constitution pour étendre son pouvoir. Mais jusqu’où ira « Robocop » ?
Kaïs Saïed intrigue. Surgi de la périphérie de la classe politique, élu le 13 octobre 2019 avec 73 % des voix, entouré d’une aura d’homme providentiel dans un contexte de désenchantement démocratique, porteur d’un projet constitutionnel hors-norme visant à « inverser la pyramide du pouvoir », ce personnage atypique défie les analyses conventionnelles : d’où lui vient sa popularité ? Comment a-t-il pu gagner une élection sans argent, sans l’investiture d’une organisation politique, sans relais médiatique ? Quelles sont ses intentions ? A-t-il les soutiens et les capacités nécessaires pour les mettre en œuvre ?
Après dix-huit mois de présidence, durant lesquels il n’a cessé de menacer de ses « missiles » la classe politique discréditée, confinée dans ses querelles, impuissante à résoudre les crises financière, sociale, sanitaire, il passe subitement à l’action au soir du 25 juillet 2021, s’arrogeant les pouvoirs d’exception que lui accorde la Constitution en cas de péril imminent. Avant de les outrepasser immédiatement : il gèle le Parlement et destitue le gouvernement. Une initiative accueillie par un soulagement quasiment général et des scènes de liesse dans toutes les villes du pays. La belle histoire de la transition démocratique tunisienne, rescapée du « printemps arabe », déraille et bascule dans l’inconnu.
Kaïs Saïed inquiète dès lors plus encore qu’il intrigue. A-t-il perpétré un coup d’État ou tiré « le frein d’urgence » pour éviter une catastrophe imminente ? Est-il le vecteur de la dimension plébéienne de la révolution, mise à l’écart par la transition institutionnelle, ou l’instrument des secteurs de l’État désireux de récupérer les pouvoirs que lui a ôtés la démocratisation ? Ne serait-il pas en train de détruire les institutions pour se tailler une stature d’autocrate ?
Pressé de toute part de régulariser la situation, Kaïs Saïed pérennise l’état d’exception par un décret-loi du 22 septembre et s’attribue quasiment les pleins pouvoirs. Il annonce le 13 décembre un calendrier ponctué par une consultation populaire, un référendum sur une nouvelle constitution le 25 juillet 2022 et des élections législatives le 17 décembre suivant. Pour autant, il ne parvient pas à rassurer, ni sur sa capacité à contrôler les effets autoritaires de la transformation politique qu’il a enclenchée et qu’il conduit seul, ni sur sa capacité à résoudre les crises financière et sociale. Au fil du temps et de la communication officielle, les analyses et les prises de position s’alignent de plus en plus sur l’idée que Kaïs Saïed entraîne la Tunisie sur la voie d’une nouvelle dictature. Crainte légitime, mais qui n’épuise pas la compréhension du personnage, ni le sens de cette bifurcation dans la trajectoire politique tunisienne.
Pour tenter de ramener Kaïs Saïed à du connu, il est comparé à Robespierre, à Napoléon III, au général Boulanger, au général de Gaulle… Ces références renvoient à la solitude d’un président inspiré par une vision transcendante du destin collectif, qui endosse la mission de la réaliser seul et n’admet pour seuls juges que Dieu, le Peuple et l’Histoire. « Kaïs Saïed a une perception messianique de lui-même », a commenté Sana Ben Achour, juriste et militante féministe. La métaphore prophétique est fructueuse pour décrire la posture, mais elle suggère aussi l’existence d’un message dont il serait le porteur. Comme tout prophète, il est sans ascendance. Il n’est pas issu des familles de l’aristocratie tunisienne, telles justement les Ben Achour : une lignée de théologiens et de juristes dont le destin est lié au « réformisme » tunisien, c’est-à-dire l’entreprise de transformation de la société par le Droit initiée au milieu du XIXe siècle. Assistant à la faculté de Tunis, la légende dit que sa thèse sur les origines du mot « Destour » (constitution) qui lui aurait permis d’accéder au rang de professeur, lui aurait été volée. Très apprécié par les étudiants qui fréquentent son cours de droit constitutionnel, il est traité avec condescendance par ses collègues.
Durant la présidence de Ben Ali, il reste discret, ne se fait pas connaître par un acte de rébellion ni même une parole d’opposition. L’événement qui va transformer le cours de sa vie se produit pendant la révolution : une rencontre avec les jeunes des provinces intérieures venus camper au cœur historique du pouvoir, la Kasbah (siège de la présidence du gouvernement) en janvier 2011, juste après la fuite de Ben Ali, pour obtenir le départ de tous les ministres issus de l’ancien régime. Ce sit-in, c’est la Tunisie des subalternes, des invisibles venus des régions d’où sont extraites les ressources qui nourrissent la prospérité relative des régions côtières, et notamment des familles du Sahel liées au pouvoir depuis l’indépendance. Leur culture politique n’est pas celle des partis de l’opposition démocratique ou islamiste. On s’y salue du nom des tribus illustres, les Frechiche, les Hammama, les Majer… qui ont écrit les grandes heures des insurrections rurales, notamment en 1864 contre le pouvoir central, en 1881 contre la conquête coloniale, et durant la lutte pour l’indépendance, de 1952 à 1956. C’est parmi eux, dans les villes de l’intérieur et les quartiers périurbains peuplés par l’exode rural, que l’on dénombre la plupart des victimes de la répression du soulèvement de 2010-2011. Dans le vide régalien laissé par l’effondrement soudain du régime, ils ont formé des comités de quartier pour les protéger des pillards et déjouer les manœuvres de déstabilisation des unités secrètes de la police. Ils ont lancé ici et là un mouvement d’occupation, de récupération plutôt, des propriétés domaniales, ces anciennes terres collectives confisquées par les colons et, depuis leur nationalisation en 1964, louées à des proches du pouvoir. La trajectoire politique de Kaïs Saïed s’enracine dans ce moment et ce terreau.
Kaïs Saïed sillonne le pays. Dans de modestes salles de café, il organise de petites réunions où il écoute les doléances et présente son projet « d’inversion de la pyramide du pouvoir ».
Les figures connues de l’opposition ne sont pas les bienvenues au sit-in de la Kasbah. Kaïs Saïed, lui, passe bien. Son allure ascétique, l’ostracisme qu’il a subi résonnent avec le ressenti des jeunes insurgés. Le second sit-in de la Kasbah, fin février, moins spontané, encadré par la centrale syndicale UGTT et les partis politiques (communiste et islamiste), oriente la protestation vers la rédaction d’une nouvelle Constitution, supposée répondre à toutes les aspirations populaires. Les jeunes sont priés de regagner leurs régions et de patienter. Ce tournant est doublement décisif pour Kaïs Saïed. D’une part, il va donner au constitutionnaliste une place quasi-permanente dans les médias pour décrypter les débats juridiques de l’assemblée constituante élue en octobre 2011. Il y gagne un respect, une image d’incorruptible et… un surnom : « Robocop », inspiré par sa diction exagérément articulée, sépulcrale et monocorde. Dans la rue, aux cafés où il s’attable, des anonymes viennent le saluer. L’obscur assistant universitaire est devenu populaire. D’autre part, il va irrémédiablement creuser son désaccord avec la tournure prise par la transition. Alors qu’en janvier 2014 les chancelleries, les grandes ONG internationales et les médias saluent « la Constitution la plus démocratique du monde arabe », Kaïs Saïed assène : « On s’est contenté de modifier un peu le partage du pouvoir entre les institutions centrales. Il a manqué une nouvelle pensée constitutionnelle. Il aurait fallu une authentique démocratie enracinée localement pour remédier aux fractures sociales et régionales. » Et de prophétiser : « Les jeunes sont actuellement tenus en marge de l’Histoire, mais ils sont en position de former une nouvelle classe politique et l’Histoire retrouvera le chemin qu’ils ont ouvert pendant la révolution. »
Son objectif est la fusion de la souveraineté populaire et de la souveraineté de l’État, que ni l’indépendance, ni même la transition démocratique, n’ont réalisée.
Son anathème n’est pas dans l’air du temps et l’isole. Alors que certains le pressent de se présenter à l’élection présidentielle de la fin 2014, il décline : le champ politique est alors saturé par un compromis négocié entre anciennes élites destouriennes (du nom du mouvement national, dit destourien, tout puissant sous l’ancien régime) et islamistes, nouveaux prétendants au pouvoir, qui, juge-t-il, « ne représentent qu'une infime partie du peuple tunisien ». Commence alors une période d’exil intérieur et de prédication. Grâce aux contacts noués durant le sit-in de la Kasbah en 2011 et au réseau de ses anciens étudiants, Saïed sillonne le pays. Dans de modestes salles de café, il organise de petites réunions où il écoute les doléances et présente son projet « d’inversion de la pyramide du pouvoir ». Dans chaque « imada » du pays (la plus petite circonscription administrative), un représentant serait élu au scrutin uninominal à deux tours parmi des candidats parrainés par un nombre égal de femmes et d’hommes, pour former des conseils locaux dans chacune des 265 délégations du territoire. Au sein de ces conseils, des représentants seraient tirés au sort pour siéger dans un conseil régional. Chaque conseil local choisirait également l’un de ses membres pour le représenter à l’Assemblée nationale. Le mandat des élus serait révocable par les électeurs. La représentation ne serait plus ainsi structurée par des partis politiques, « forme dépassée » selon Kaïs Saïed, mais par les territoires.
Cette « campagne d’explication » passe totalement sous le radar et quand, quelques mois avant la présidentielle de 2019, un sondage place Kaïs Saïed parmi les favoris, personne ne veut y croire. Sans argent, sans parti, il apparaît comme un idéaliste égaré dans un univers cynique. La victoire semble promise à Nabil Karoui, sorte de Berlusconi tunisien, rescapé de l’ère Ben Ali grâce à son opportunisme, son argent et le poids médiatique de sa chaîne de télévision. Les électeurs rejetteront en masse cette antithèse de Kaïs Saïed dont le slogan, « Ech’chaab yourid » (« le peuple veut »), est inspiré de celui de la révolution (« le peuple veut la chute du régime »). Il s’implique à peine dans sa campagne électorale, orchestrée comme un appel venu des profondeurs du pays, lancé par une myriade de pages Facebook où s’expriment les sensibilités idéologiques les plus contradictoires, de l’extrême gauche aux islamistes. Plus qu’un vote par défaut, il suscite un réel élan, notamment auprès des citoyens qui s’étaient éloignés des urnes : plus du tiers de ses électeurs n’avait pas voté en 2014.
Une semaine après son triomphe, une vaste campagne de nettoyage des espaces publics s’organise spontanément dans tout le pays. Un mouvement qui conforte le récit de Kaïs Saïed qui vante un peuple vertueux, trahi et dépossédé de son pouvoir par des élites corrompues, prêt à s’investir dans la cité pour peu qu’il sente que sa voix compte. Mais comment transformer cette énergie, avec laquelle Kaïs Saïed se sent connecté, en action politique ? Hormis l’évocation d’un retour à l’État social promu lors de l’indépendance, il incarne plus qu’il ne propose. « Je me refuse à faire des promesses, n’avait-il cessé de répéter avant son élection. Je ne ferai que permettre au peuple d’exercer sa volonté. » « Let my people go ! » en quelque sorte… Alors que la transition démocratique a perdu sa signification et oublié ses ambitions au fil de la première législature – réformes en panne, dégradation de la situation économique, vie institutionnelle saturée par les luttes de pouvoir et les tractations occultes entre Nidaa Tounes, héritier du mouvement destourien, disloqué par les querelles de clans, et Ennahdha, le parti islamo-conservateur –, les élections de 2019 sanctionnent cet immobilisme. L’irruption de Kaïs Saïed résonne comme une rupture, comme l’annonce prophétique d’un ordre nouveau. Plus exactement, il annonce une « rectification du processus révolutionnaire, confisqué par les partis », comme il le dira plus tard. Kaïs Saïed oppose en effet le 17 décembre 2010, jour de l’immolation de Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid, symbole d’une révolution venue des marges, au 14 janvier 2011, jour de la chute de Ben Ali, qui réduit la portée du soulèvement à une dimension purement institutionnelle. Pour lui, le 17 décembre marque le surgissement des thématiques sociales, portées par les invisibles qui soulèvent les questions jusque-là indicibles : l’asymétrie de la construction de l’État et la « colonisation intérieure », l’inégalité des dignités dans l’ordre social et culturel… Alors que le 14 janvier se contente de redistribuer les cartes et les postes entre acteurs centraux. S’il est un message dont Kaïs Saïed est le vecteur, c’est l’aspiration à une réconciliation de la société avec son État, construit historiquement comme une excroissance prédatrice et surplombante. Ambitieux, son objectif ultime est la fusion de la souveraineté populaire et de la souveraineté de l’État, que ni l’indépendance, ni même la transition démocratique, n’ont réalisée.
Plus le temps passe, plus il s’appuie sur les « corps solides » de l’État, c’est-à-dire l’appareil sécuritaire, dans son entreprise de refondation de l’ordre politique.
Mais sur la route de Kaïs Saïed vers la « Terre promise » – la restitution du pouvoir au « peuple », selon ses termes – se dresse un obstacle de taille : comment les partis installés dans les institutions accepteraient-ils les bouleversements qui leur ôteraient le pouvoir ? « Le Président utilisera les brèches de la Constitution et le moment venu, misera sur l’épuisement de la légitimité parlementaire pour agir », confiait, dès novembre 2019, un des jeunes organisateurs de sa campagne électorale. Loin de l’hésitation ou de l’absence de stratégie que beaucoup lui prêtent, cette prévision, Kaïs Saïed révèle une capacité à sentir les mouvements plus lents et plus profonds que l’agitation du microcosme, et à utiliser les circonstances pour avancer. Dès janvier 2020, il joue des subtilités et des ambivalences de la Constitution pour prendre la main sur la formation du gouvernement avant de la perdre au cours de l’été suivant, lors d’une longue confrontation avec Rached Ghannouchi, président d’Ennahdha et de l’Assemblée, qui, depuis le perchoir, entend contrôler le travail gouvernemental. Mais, déconnectée des émotions populaires, l’Assemblée offre des scènes grand-guignolesques. Dès lors, la crise s’aggrave et le pacte sacré entre représentés et représentants est rompu.
Au dégoût qu’inspire la classe politique s’ajoute l’effroi quand la gestion calamiteuse de la pandémie au printemps 2021 débouche sur une catastrophe sanitaire en juillet : au spectacle des malades agonisant jusque sur les trottoirs des hôpitaux succède celui des sacs mortuaires entassés dans les couloirs. De fait, il suffit d’un discours au soir du 25 juillet pour que l’édifice institutionnel péniblement mis en place depuis 2014 s’écroule au profit du pouvoir d’un seul. Un blindé interdit l’accès au Parlement, mais la classe politique est tétanisée par l’immense soutien populaire dont bénéficie l’initiative présidentielle (plus de 80 % dans les premières semaines). Mais le peuple dont Kaïs Saïed prend la tête, loin d’être unifié, exprime des exigences hétéroclites : application de la loi contre les corrompus de la classe politique et de l’administration, contre les spéculateurs qui font monter le prix des denrées alimentaires ou des médicaments, éviction d’Ennahdha du pouvoir, obstacle à la poursuite de la révolution pour la gauche, produit de révolution pour les partisans de l’ancien régime ; mise en œuvre des accords conclus avec le gouvernement pour le règlement des conflits sociaux de la décennie écoulée (souvent des embauches dans le secteur public ou les dispositifs d’emplois aidés) restés lettres mortes faute de moyens ; reconcentration du pouvoir que la Constitution de 2014 a éclaté entre différentes autorités…
Le « peuple » n’a d’essence et d’unité que comme construction discursive, à moins d’être la conscience en acte d’un collectif pour soi en lutte pour la reconnaissance de son existence politique. Or, le « peuple » de Kaïs Saïed se réduit-il à celui qui parle en son nom, identifié à la part saine et patriotique de la nation ? La verticalité de l’État qu’il entend incarner a pris le pas sur l’horizontalité du pouvoir populaire qui l’avait inspiré. Le temps de l’auto-organisation de l’hiver 2011 est passé. Ses partisans ont formé des coordinations locales, mais mobilisent peu. Aucun dispositif de délibération, ni avec les citoyens, ni a fortiori avec les organisations intermédiaires dont il réfute la légitimité, n’accompagne l’élaboration des réformes politiques. L’implication des Tunisiens s'est limitée à une consultation populaire en ligne au premier trimestre 2022, à laquelle un demi-million de personnes répondent, loin des deux ou trois millions escomptés.
Légitimé par sa large victoire électorale, le chef de l’État se veut seul dépositaire de « la Loi » énoncée par la vox populi, et refuse avec constance tous les conseils, toutes les propositions en dehors de celles d’un entourage aussi restreint qu’opaque. Même la centrale syndicale historique (l’UGTT) et les partis disposés à apporter un soutien critique à son entreprise de réforme politique, ont fini par prendre leurs distances. Devant son refus persistant de dialoguer, ils réfutent la légitimité de ses décisions. De plus en plus isolé, incapable d’élargir sa base de soutien, il semble ne s’en remettre qu’au ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine. Plus le temps passe, plus il s’appuie sur les « corps solides » de l’État, c’est-à-dire l’appareil sécuritaire, dans son entreprise de refondation de l’ordre politique. Abreuvé de rapports des services de renseignement, il ne cesse de dénoncer « les complots et les manigances », voire les projets d’assassinat. Dans un geste de symbolique, c’est depuis le ministère de l’Intérieur, symbole et pilier de l’ancien régime, qu’aucun gouvernement démocratique n’a eu la force de réformer depuis 2011, que le chef de l’État a annoncé, le 7 février dernier, au milieu de la nuit, la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature, dont la politisation était certes décriée. Avant de le remplacer par une nouvelle institution provisoire et de s’arroger le droit de s’opposer à ses décisions. Pour le moment, malgré quelques procès de civils devant les juridictions militaires, l’assignation à résidence d’un cadre d’Ennahdha puis l’arrestation de l’avocat qui le défendait (tous deux libérés), la Tunisie est loin de l’Algérie, du Maroc ou de l’Égypte en matière d’atteintes aux libertés. Mais une configuration juridique et politique dans et par laquelle il est possible d’abuser du pouvoir se met en place.
L’élan du tant prophétique 25 juillet s’empêtre dans le filet des contingences. Les cours du pétrole et du blé flambent, et avec eux les dépenses budgétaires liées aux subventions de l’énergie et des produits de première nécessité. Les échéances de la dette publique extérieure se dressent comme un mur à l’horizon 2023. Les agences de notation anticipent désormais un défaut de paiement de l’État, jugé quasi inéluctable à brève échéance. Avec pour conséquence une alternative désastreuse : soit une restructuration de la dette devant le Club de Paris au prix d’une cure d’austérité draconienne, soit une crise financière comparable à celle du Liban. Dans les deux cas, le choc social aura des conséquences politiques imprévisibles. Pour maintenir la foi dans l’épreuve, obtenir un relatif consentement aux sacrifices, il faudrait offrir un récit mobilisateur et un avenir désirable. Or, le verbe de Kaïs Saïed bégaie. De discours en discours, il répète les mêmes éléments de langage. Tel le Moïse des « Dix commandements » à son retour du Mont Sinaï qui retrouve son peuple vautré dans l’adoration veau d’or, il menace : « Qui ne vit pas selon la Loi, périra par la Loi ! » Il vitupère contre « les réseaux qui mangent l’argent du peuple », dénonce « les voleurs et les corrompus qui ont transformé le Parlement en marché », et légifère contre les spéculateurs rendus responsables des pénuries alimentaires et de l’augmentation des prix sans rien régler des maux structurels de l’économie tunisienne.
Légitimé par sa large victoire électorale, le chef de l’État se veut seul dépositaire de « la Loi » et refuse toutes les propositions en dehors de celles d’un entourage aussi restreint qu’opaque.
Kaïs Saïed parviendra-t-il à atteindre le rivage de sa « Terre promise », un référendum sur une nouvelle Constitution et des élections suffisamment légitimes pour créer une nouvelle réalité juridique et politique incontestable ? Ou sera-t-il englouti avant par un soulèvement social ouvrant la possibilité d’une destitution ? Si Kaïs Saïed s’avérait être le nom d’une nouvelle déception, les problèmes structurels du modèle tunisien que la transition démocratique n’a pas résolus, la fracture entre la société et ses représentants demeureront, mais le message trouvera une nouvelle manière de se faire entendre.
...
Pas encore abonné(e) ?
Voir nos offresLa suite est reservée aux abonné(e)s
Déjà abonné(e) ? connectez-vous !