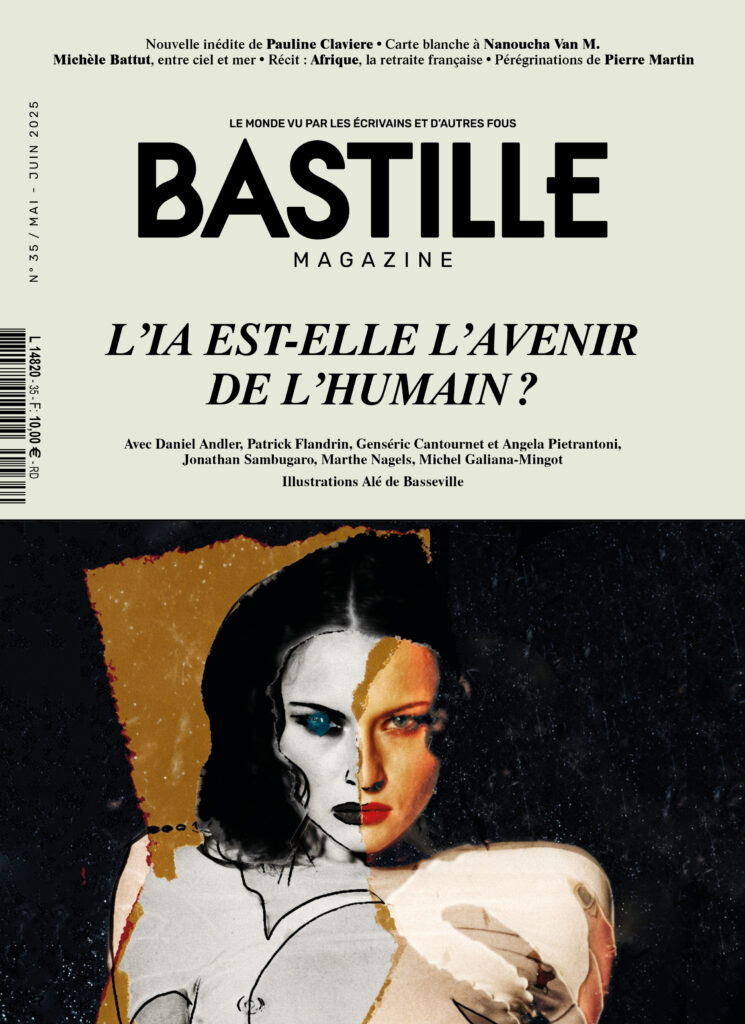« Un émerveillement devant la lumière renouvelée, une lutte contre la bile noire, un tâtonnement, un oubli qu'il essayait de vaincre », écrit Valérie Zenatti dans Le Faisceau des vivants, à propos de celui dont elle a brillamment traduit une grande partie des publications en France. Si Aharon Appelfeld (1932-2018) est considéré comme l’un des piliers de la littérature israélienne contemporaine (mais aussi comme un « écrivain de la Shoah », ce qui ne lui plaisait guère), il a grandi dans un univers polyglotte. En 1944, enrôlé comme coursier par l’Armée rouge, celui qui s’appelle encore Ervin apprivoise le russe. À son arrivée en Israël à l’âge de 13 ans, l’âge d’une bar-mitsva pour laquelle il n’a pu être entouré de sa famille, exterminée par les nazis, il doit apprendre l’hébreu. C’est cette langue qu’il choisit pour écrire ses quarante-cinq livres, dont la plupart sont hantés par la terre européenne, Le Monde d’hier narré par Zweig, les shtetls disparus ou les personnages métaphoriques de Kafka, dont le corpus l’a durablement marqué. Aharon Appelfeld construit un récit à la fois très centré du point de vue spatio-temporel et absolument contemporain. Après la publication posthume de Mon père et ma mère – qui revenait sur le dernier été passé en famille avant la Seconde Guerre mondiale, contaminé par la catastrophe à venir – les éditions de l’Olivier, qui ont eu à cœur de transmettre l’œuvre d’Appelfeld dans l’Hexagone depuis 2004, publient deux ouvrages. Une réédition de L’Héritage nu, qui regroupe trois conférences données à la Columbia University, où…

Aharon Appelfeld ©Patrice Normand
L’héritage Appelfeld
Sophie Rosemont