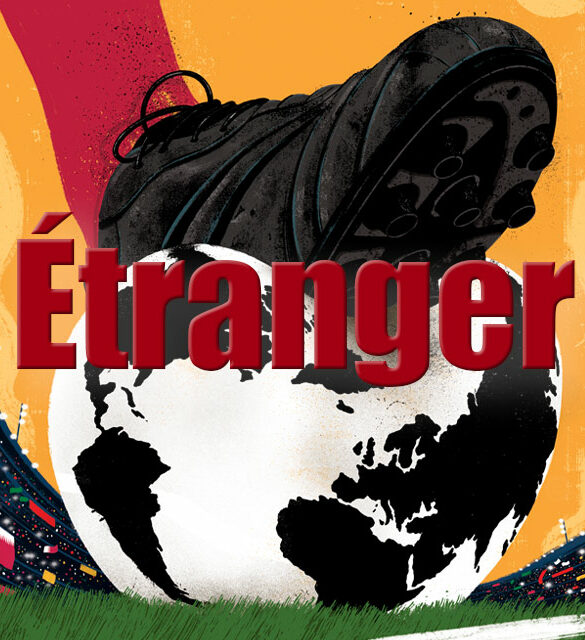L’étranger fait l’objet de nombreux fantasmes. La construction de cette figure a des conséquences matérielles et symboliques bien réelles, alimentant tous les amalgames. D’un point de vue philosophique, l’étranger se définit comme étant l’antonyme de l’identité – le caractère de ce qui est autre. Un concept précaire qui n’existe pas comme essence, sinon dans une négativité, une relation d’exclusion, par rapport à ce qu’il n’est pas. Entre ce qui d’un côté est perçu comme soi (ou comme nous) et de l’autre ce qui échappe à ses frontières.
Les discours médiatiques et politiques concernant ceux que l’on nomme les étrangers amènent à s’interroger sur la place qu’ils occupent dans l’imaginaire collectif. Tantôt perçus comme une menace extérieure (servant parfois de bouc émissaire à une société qui peine à penser sa cohésion), tantôt comme des individus sans histoire personnelle qu’il faudrait accueillir, civiliser ou assimiler. La menace de l’annihilation par l’assimilation, la négation, l’infantilisation, l’impossibilité de partager la douleur du monde : voici toute la dimension universelle et atemporelle de ce drame intime. Contraint de reconstruire sa vie, de penser et de s’exprimer dans une nouvelle langue, l’étranger vit plusieurs vies en une. La multiplication de ses identités entraîne souvent un dessaisissement de soi, une perte de sa propre existence – choc inconscient au-delà de la volonté. Dans la dialectique inhérente aux identités marginalisées – entre célébration politique de la différence et effacement stratégique au sein d’une culture hégémonique – se crée à chaque fois
une vie singulière.
Rabelais, Montaigne, Montesquieu, Erasme, Diderot, Kant, Nabokov, Camus, Kristeva, Anders, tous ont médité les merveilles et les malaises de la vie étrangère – figures de l’errance qui nous poussent à interroger par leur parcours la notion même de cosmopolitisme, entre les processus de fabrication en série du même, et les vicissitudes d’une histoire singulière. Ainsi l’inquiétante étrangeté de Freud suggérerait une nouvelle voie éthique : ne pas vouloir assimiler l’étranger, mais respecter son désir de vivre différemment, lui accorder un droit à la singularité, dans le respect ultime des droits et des devoirs humains.
« Je viens d’un pays qui n’existe plus » chantait Dalida, cette étrange étrangère qui a longtemps brouillé, sciemment ou non, les pistes des appartenances culturelles. La chanteuse a su puiser dans l’inconscient collectif, profondément et intimement, évoquant la nostalgie de l’Égypte cosmopolite de son enfance sans pour autant dissimuler son attirance pour pour son pays choisi, la France. Comme, avant elle, Joséphine Baker qui chantait « J’ai deux amours, mon pays et Paris », elle a construit son répertoire autour d’une double appartenance, à sa terre natale, jamais reniée, et à sa terre d’accueil, inlassablement célébrée.
Au contraire de l’assimilation, l’intégration n’impose aucun renoncement aux origines. Pour marquer le véritable élargissement identitaire qui accompagne une migration heureuse, la langue allemande distingue le pays de naissance, celui que l’on porte toujours en soi (Heimat), de la patrie, entité géographique et politique (Vaterland). En franchissant une frontière, on peut choisir une nouvelle vaterland sans pour autant se couper jamais de son heimat. Loin de s’opposer, ces deux notions enrichissent l’étranger, le distinguent : fidèle à une famille, à une culture, à une langue, il peut néanmoins développer un sentiment patriotique pour le pays où il a choisi de vivre. Héroïne de la résistance à l’occupant, Joséphine Baker, encore elle, née Américaine et aujourd’hui admise au Panthéon, pourrait en témoigner.
C’est une tâche philosophique de premier ordre : penser l’irréductible étrangeté qui marque l’Autre, tout Autre. Et avec elle, la responsabilité morale comme structure essentielle, première, de la subjectivité. Car percevoir l’étranger comme étranger à l’Humanité, c’est l’amputer d’une partie d’elle-même. C’est être suffisamment déshumanisé pour déshumaniser à son tour un autre être humain.