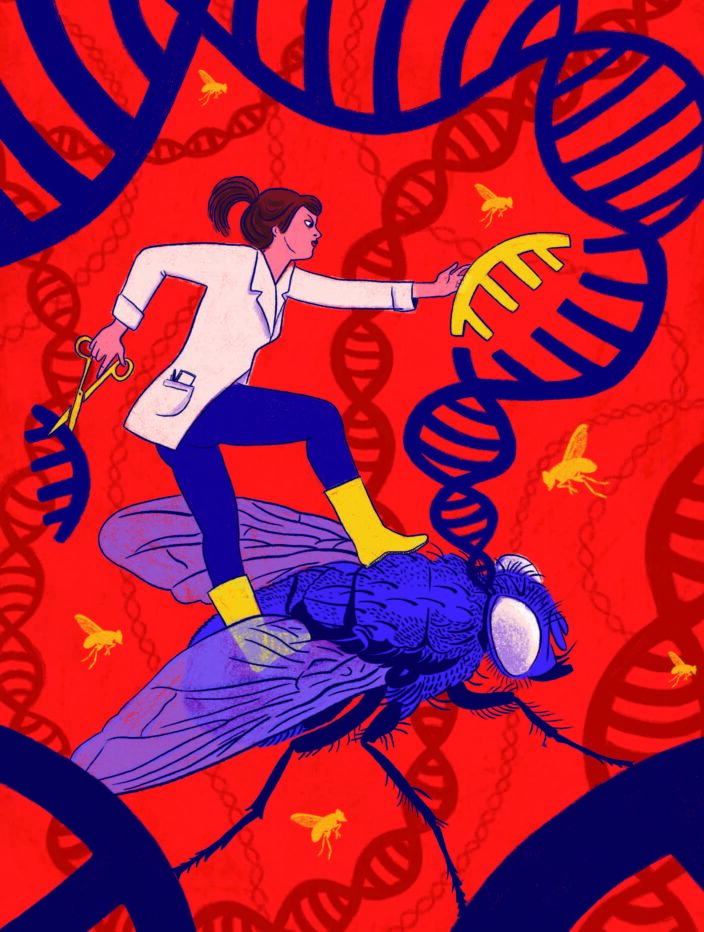Mécanismes et schémas de l'évolution, risques et promesses du forçage génétique... Des questions pour lesquelles Virginie Courtier-Orgogozo se passionne. La biologiste, directrice de recherche au CNRS, occupe cette année la chaire Biodiversité et écosystèmes du Collège de France. Avant-goût d’un cours qui interroge notre rapport à la nature et ses enjeux. Propos recueillis par William Emmanuel et Michel Palmieri.
Comment présenteriez-vous l’objectif de vos recherches ?
Comprendre l’évolution du monde vivant et améliorer la théorie de l’évolution élaborée par Charles Darwin et Alfred Wallace, en y incorporant les gènes et les mutations.
Avez-vous déjà quelques conclusions à ce stade ?
Oui. En étudiant les mutations qui sont apparues au cours de l’évolution des espèces et qui ont contribué à la modification de leurs caractéristiques observables, on s’est rendu compte que l’évolution se répète : les mêmes traits de caractère apparaissent, indépendamment, dans différents milieux, liées à des mutations dans les mêmes gènes. Par exemple, suite à l’épandage d’insecticides pyréthrinoïdes un peu partout dans le monde, plus de 40 espèces d’insectes ont développé des résistances, grâce à des mutations différentes qui touchent toutes le même gène ! Les mutations apparaissent aléatoirement sur les chromosomes. Celles qui confèrent une résistance se disséminent alors au fil des générations dans les populations sous l’effet de l’insecticide, qui sélectionne les individus résistants.
En pratique, comment suivre cette évolution sur plusieurs générations ?
En laboratoire, nous travaillons sur les drosophiles, de petites mouches de 2 millimètres de long qui produisent énormément de descendants. À 25 °C, il ne s’écoule que dix jours avant qu’une femelle issue d’un œuf ponde à son tour un nouvel œuf. Il y a peu d’espèces d’insectes qui ont un temps de génération si court. Dans la nature, on pense que c’est plutôt autour de vingt jours. Les drosophiles commencent à sortir au printemps et à l’automne, elles disparaissent. On ne sait pas encore très bien où elles passent l’hiver.
Que sait-on aujourd’hui de ces drosophiles ?
Depuis les travaux du prix Nobel Thomas Morgan, dans les années 1900, la drosophile est devenue le modèle d’étude favori des généticiens. D’autant que son élevage ne coûte rien : vivant près de nos poubelles, elle est peu regardante vis-à-vis de sa nourriture et survit très bien au laboratoire. Dans les premiers temps, quand on commençait à analyser les chromosomes, une autre particularité était vraiment utile : dans les glandes salivaires des drosophiles, les chromosomes se multiplient au sein des cellules et plusieurs milliers de copies de la même molécule d’ADN se collent les unes aux autres. Les chromosomes deviennent alors très gros et on peut les observer avec un petit microscope optique, ce qui a grandement facilité leur étude. Au fil des ans, les chercheurs ont accumulé énormément d’informations sur cette mouche. Par exemple, on a décrypté son génome avant celui des humains. Généralement, les connaissances acquises sur les mouches s’appliquent aussi aux humains car les mêmes mécanismes de fonctionnement se retrouvent dans la plupart des êtres vivants.
Personnellement, je ne suis pas plus fascinée par les insectes que par d’autres organismes. Mais, comme j’adore la génétique, la drosophile s’est naturellement imposée à moi comme l’organisme idéal à étudier. D’autant que, sur une mouche, on a peu d’états d’âme, même si elles sont en fait très intelligentes et capables de tant de choses qu’un jour il sera peut-être interdit de travailler sur elles.
Vous parlez d’intelligence…
Les drosophiles font des choses incroyables. Par exemple, les femelles vierges sont attirées par les mâles qui viennent les courtiser. Mais dès qu’elles sont fécondées, elles les repoussent – on s’est aperçu que c’était l’effet des protéines produites par les mâles et inséminées dans la femelle avec les spermatozoïdes qui changent le comportement de la femelle. Pour l’heureux élu, que la femelle perde ensuite toute envie de copuler avec d’autres augmente considérablement ses chances d’avoir des descendants. Pour les autres mâles, c’est une autre affaire. On a étudié leurs réactions en mettant des mâles vierges en présence de femelles ayant déjà copulé. Systématiquement rejetés, ils vont tendre à rechercher des nourritures contenant de l’alcool.
Ils entrent dépression et donc ils boivent ?
On ne sait pas trop, mais ce qu’on constate, c’est que, lorsqu’ils sont rejetés par les femelles, les mâles se mettent à boire, alors que s’ils peuvent copuler, ils ne touchent pas à l’alcool. L’analogie avec les humains est tentante.
D’autres expériences montrent que les drosophiles sont capables de se transmettre des informations. Si vous les mettez dans une cage contenant deux types de nourriture, l’une parfumée à la banane et l’autre goût fraise mais contenant des substances toxiques, elles vont vite s’habituer à ne manger que de la banane. Si ensuite vous les placez dans une autre cage, contenant elle aussi deux types de nourriture, parfums banane et fraise mais cette fois sans produits toxiques, et que vous ajoutez d’autres mouches naïves, qui n’ont pas participé à la première phase de l’expérience, elles suivront leurs congénères et toutes ne mangeront que de la banane !
Que concluez-vous de ces expériences ?
Je pense qu’elles ont leur propre façon d’appréhender le monde et qu’on commence seulement à en prendre conscience. Au laboratoire, pour comprendre l’évolution des espèces, on s’intéresse plutôt à leur anatomie, c’est plus facile à étudier que les comportements. On a beaucoup travaillé sur les parties génitales parce que, chez tous les animaux à fécondation interne, ce sont les parties du corps qui évoluent le plus vite. Quand on compare des espèces très proches, les premières différences morphologiques qu’on observe se situent au niveau des parties génitales. Les gènes de la reproduction font partie des gènes qui évoluent le plus vite, parce que l’évolution sélectionne en continu les individus qui se reproduisent plus que les autres. Ce qui est intéressant aussi, c’est que les gènes des mâles évoluent plus vite que ceux des femelles. Un mâle drosophile, en théorie, peut donner un nombre très varié de descendants, de zéro à plusieurs centaines de milliers. Alors qu’une femelle drosophile est plus limitée dans le nombre d’œufs qu’elle va pouvoir pondre au cours de sa vie. Cela a pour conséquence que la sélection naturelle pour la reproduction est plus forte chez les mâles que chez les femelles. C’est vrai aussi pour les humains, et, plus généralement, pour tous les animaux à reproduction sexuée.
Comment ces modifications génétiques affectent-elles les caractères visibles de l’espèce ?
Souvent, plusieurs gènes participent à la formation d’un trait de caractère, mais l’évolution ne va pas affecter n’importe lequel de ces gènes. En général, les gènes qui seront modifiés sont ceux dont les mutations agissent comme des interrupteurs. Par exemple, il y a un grand nombre de gènes impliqués dans la formation des poils de la mouche. Mais celui qui va être responsable, prioritairement, des changements de position et du nombre de poils au cours de l’évolution, c’est le gène qui en contrôle le développement : quand il est éliminé, il n’y a plus de poils. Et quand il est exprimé dans une nouvelle région du corps, des poils additionnels apparaissent.
Après sa mutation, un gène se réplique-t-il de la même manière ?
Une fois qu’il y a une mutation, la cellule ne voit pas la différence. Imaginez un livre que quelqu’un aurait recopié en remplaçant un mot par un synonyme : il sera impossible de s’apercevoir du changement si l’on ne dispose plus de la copie de départ. Pour la cellule, c’est pareil : une fois qu’il y a mutation, rien ne permet de distinguer la nouvelle séquence d’ADN de l’ancienne.
Quels sont les effets de ces mutations ?
La plupart des mutations qui apparaissent et qui changent le génome n’ont pas d’effet. C’est la théorie neutraliste de l’évolution, développée dans les années 1970. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les mutations qui affectent les caractères. La sélection naturelle supprime un grand nombre d’individus mais, en même temps, elle favorise certains traits de caractère : une meilleure survie, une meilleure adaptation aux interactions avec d’autres espèces, une transmission accrue chez les virus, etc.
"Nous, scientifiques, sommes habitués au doute et aux incertitudes, alors que le grand public a plutôt tendance à avoir une opinion tranchée."
Dans le cas des virus, et plus particulièrement du coronavirus qui a très récemment paralysé la planète, y a-t-il un lien entre le caractère pathogène et la capacité à se propager ?
Quand le coronavirus SARS-CoV-2 a commencé à affecter les populations humaines, on ne savait pas comment il allait évoluer, car pour chaque virus, c’est différent. Certains scientifiques ont affirmé que la virulence allait diminuer. Mais nos connaissances en virologie ne sont pas encore assez matures pour conclure avec certitude. La seule chose certaine, c’est que l’évolution sélectionne des virus de plus en plus transmissibles. Parfois, il y a un compromis entre la virulence et la transmission, et du coup, le virus devient moins pathogène au fil du temps. Dans d’autres cas, il arrive que les mécanismes moléculaires qui augmentent la transmission augmentent aussi l’effet du virus sur l’organisme, et on se retrouve alors avec des virus de plus en plus virulents.
Il y a vingt ans, il y a eu le SRAS, qui était aussi un coronavirus. Qu’est-ce qui a limité les effets de l’épidémie ?
La différence décisive, c’est que les symptômes du SRAS étaient très forts et qu’il n’y avait pas d’asymptomatiques. Les Chinois ont pu réagir vite et maîtriser l’épidémie. Si cette fois ils n’ont pas pu, c’est sans doute parce qu’il y avait beaucoup d’asymptomatiques.
Que sait-on aujourd’hui de l’origine de l’épidémie ?
On est sûr que le virus provient de la chauve-souris. Après, comment il est passé de la chauve-souris à l’homme, c’est moins clair. Y a-t-il eu un hôte intermédiaire ? On ne sait pas. On a parlé du pangolin. Au Muséum d’histoire naturelle, dans la Grande Galerie de l’Évolution, il y a un pangolin devant lequel aujourd’hui tout le monde s’arrête, alors qu’avant personne ne le regardait. Cet animal est devenu célèbre. Mais le virus a pu passer directement à l’homme, auquel il était déjà assez adapté. On ne peut pas rejeter l’hypothèse d’un accident de laboratoire. À Wuhan, plusieurs centres de recherche sont connus pour leurs travaux sur les coronavirus. Il est possible qu’ils aient récolté des échantillons de chauves-souris et que quelqu’un se soit contaminé – peut-être même sans le savoir, s’il était asymptomatique – et qu’il l’ait transmis à sa famille. C’est vraiment possible, ce n’est pas criminel, les accidents de laboratoire sont fréquents, et pas qu’en Chine. Le problème c’est que c’est vite devenu très politique.
C’est l’hypothèse que vous privilégiez ?
Très franchement, je ne sais pas. Les données ne sont pas concluantes, ni dans un sens ni dans un autre. Nous, scientifiques, sommes habitués au doute et aux incertitudes, alors que le grand public a plutôt tendance à avoir une opinion tranchée sur la question.
La fréquence de ce type d’épidémies devrait-elle augmenter à l’avenir ?
Oui. Plus la population est nombreuse, plus un virus adapté a de chances de s’y propager. C’est pourquoi les grandes populations subissent généralement plus d’épidémies et sont plus immunisées que les petites. Quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique, les indigènes étaient peu nombreux et n’avaient pas connu énormément de virus. Ce qui les a décimés, ce sont surtout les pathogènes importés d’Europe. D’autres paramètres influencent aussi la fréquence des épidémies : les contacts avec les animaux sauvages et le volume des flux de personnes.
Diriez-vous que l’espèce humaine s’est fragilisée ? Est-ce que Cro-Magnon n’était pas plus solide que nous ?
On est adaptés à notre environnement. Si on nous projetait 10 000 ans en arrière, nous vivrions moins bien que les autres. De même que nos lointains ancêtres seraient mal à l’aise dans notre époque.
Est-ce qu’ils survivraient ?
Déjà on ne peut pas faire l’expérience donc je peux dire ce que je veux, vous ne pourrez pas me contredire [elle rit]. Du point de vue de l’évolution, il n’y a pas de valeur positive ou négative. Elle se contente de sélectionner, à chaque génération, les individus les plus aptes à se reproduire et à survivre. Et donc nous, qui sommes le résultat de cette sélection, sommes de ce fait une sorte de « mieux possible » à un moment donné.
Est-il possible d’imaginer que l’être humain soit capable de s’adapter aux bouleversements climatiques ?
Sûrement. Les humains s’adaptent. Le réchauffement climatique aura des répercussions sur notre génome, au fur à mesure des générations. L’évolution va beaucoup plus vite que ce qu’on imaginait.
Le changement climatique aussi va vite et impacte violemment le vivant. Pour les espèces, certains parlent d’un rythme de disparition de 100 à 1 000 fois supérieur au rythme naturel d’extinction.
Depuis les premiers recensements, dans les années 1970, les effectifs des populations de vertébrés ont chuté de 65 % en moyenne. Le nombre d’espèces diminue lui aussi, à cause de la destruction des habitats naturels. L’impact des humains sur la planète est très, très fort.
Et puis il y a le réchauffement climatique, la pollution et tous les échanges qui font que des espèces invasives vont se répandre facilement dans une zone, entrer en compétition avec d’autres espèces et les éliminer.
L’état actuel des connaissances scientifiques en matière d’évolution est-il compatible avec les croyances religieuses ?
Mais oui, il y a des biologistes de l’évolution qui croient en Dieu. Simon Conway Morris, un paléontologue britannique remarquable, est chrétien. Il pense que, au tout début, quelque chose a insufflé la vie sur la terre. Ça ne gêne pas trop parce que finalement on sait très peu de choses sur le début de la vie.
Et vous ?
J’ai été élevée dans une famille catholique très croyante. Puis, à l’adolescence, je me suis mise à douter. Aujourd’hui, je suis agnostique. Mon envie de savoir comment l’évolution sur Terre a pu donner l’espèce humaine est peut-être plus forte chez moi que chez d’autres scientifiques qui n’ont pas été élevés dans la religion, car je ressens un vide par rapport aux explications qu’on m’avait fournies dans l’enfance. J’ai envie de combler ce vide en trouvant des réponses.
C’est ce qui a déterminé votre vocation de chercheuse ?
C’est surtout mon émerveillement devant la nature qui m’a poussée dans cette voie. Pour se lancer dans la recherche, il faut d’abord avoir une passion forte. Ensuite, il faut être capable de persévérer car la recherche, c’est difficile, souvent on ne trouve pas…
Vous travaillez sur les OGM ?
Sur certains types, ceux du forçage génétique. Le forçage génétique est une nouvelle technique mise au point en 2015 pour fabriquer des OGM particuliers, capables de transmettre les gènes modifiés à 99 % de leur descendance.
Quel est l’effet recherché ?
L’ambition, c’est de modifier génétiquement toute une population, en relâchant des individus porteurs du gène modifié dans la nature, pour qu’ils se croisent avec des individus sauvages et que, au fur et à mesure des générations, la mutation se répande jusqu’à ce que 100 % des mâles et des femelles aient ce gène. L’une des applications envisagées est l’extinction des populations de Drosophila suzukii, une mouche qui attaque les fruits et qui a commencé à envahir l’Europe en 2008. Les simulations numériques montrent qu’en introduisant par forçage génétique une modification qui rend toutes les femelles stériles, la population devrait s’éteindre en une douzaine de générations. L’expérience a été réalisée dans de grandes cages au laboratoire avec des moustiques, et la population s’éteint effectivement au bout de huit à douze générations.
C’est assez inquiétant.
Oui, très. Mais, pour l’instant, les expériences ne sont menées que dans quelques laboratoires, et pas en plein champ. Et même si, à l’échelle internationale, les règles sont les mêmes que pour les OGM classiques, les chercheurs qui travaillent sur le forçage génétique ont pris l’initiative d’en ajouter d’autres. Malgré les risques évidents, cette nouvelle technologie reste prometteuse. L’application principale mise en avant par les chercheurs qui développent le forçage génétique est l’éradication d’une maladie emblématique, le paludisme, qui occasionne plus de 400 000 morts par an, surtout des enfants de moins de 5 ans.
"Il me paraît important qu’il y ait des confrontations de points de vue sur le forçage génétique. Comme pour les premiers OGM."
Par quel mécanisme ?
Pour le paludisme, il y a deux approches, expérimentées en parallèle par différents laboratoires. Certains veulent rendre les moustiques résistants au parasite qui transmet le paludisme, en insérant des gènes qui codent des anticorps capables de bloquer le parasite. Ça marche bien en laboratoire et, a priori, ça ne perturberait pas trop l’écosystème. L’autre approche est de rendre les moustiques femelles stériles. Là, le but est vraiment d’éliminer les populations de moustiques, ce qui pose problème : le gène modifié étant très conservé, on peut imaginer que la mutation soit transmise à d’autres moustiques – chez les moustiques, les espèces ne sont pas totalement hermétiques – voire même à d’autres espèces très éloignées.
En principe, les croisements entre espèces différentes ne donnent pas d’individus viables.
Parfois, cela peut quand même se produire. Il arrive aussi que des fragments d’ADN parviennent à passer d’une espèce à une autre et qu’ils intègrent le nouveau génome. On ne sait pas encore très bien comment – peut-être par l’intermédiaire de virus – mais on le constate. Ces événements sont très rares et, le plus souvent, sans conséquences, mais, même faible, le risque n’est pas nul. En l’étudiant, on s’est rendu compte que pour le limiter, il fallait éviter d’intégrer le morceau d’ADN modifié dans une zone présentant des séquences répétées que l’on retrouve aussi dans d’autres espèces.
Le principe du forçage génétique fait-il aujourd’hui débat ?
Pas vraiment dans le grand public, encore peu informé. Pourtant, il me paraît important qu’il y ait des confrontations de points de vue. Comme pour les premiers OGM.
Mais au sein de la communauté scientifique internationale, les discussions sont nombreuses. En Australie, par exemple, on envisage d’utiliser le forçage génétique pour éradiquer les populations de rongeurs qui mangent les œufs d’oiseaux endémiques. Cependant, même si l’Australie est une île et même si les chercheurs s’efforcent de n’agir que sur des séquences présentes uniquement dans le génome des rongeurs d’Océanie, le risque de diffusion n’est jamais nul. Pour le paludisme, les points de vue ne sont évidemment pas les mêmes partout. Pour l’Europe, c’est facile de dire « non, ne le faisons pas » parce que le paludisme ne sévit pas chez nous. Mais pour l’Afrique, en proie à ce fléau, il est évidemment très tentant de prendre le risque de recourir au forçage génétique.
Y a-t-il d’autres applications envisageables pour cette nouvelle biotechnologie ?
Oui, en agriculture notamment, pour lutter contre les nuisibles. Et c’est peut-être là que les enjeux financiers sont les plus importants. Il nous faudra être très vigilants.
Quels pourraient être les garde-fous ?
La réglementation. Il faut vraiment que le grand public soit au courant, que les débats n’impliquent pas seulement les chercheurs, les industriels et les politiques. Nous sommes tous concernés. Dans le monde d’aujourd’hui, on est tous connectés.
Globalement, quel regard portez-vous sur le rapport de l’homme à la nature ?
Nos sociétés ont hélas réifié le vivant. Par exemple, on dit qu’on « produit » du blé. Alors qu’en fait, on se contente de le faire pousser, notre rôle est très faible. De même, quand on regarde notre smartphone, on se dit « génial, c’est incroyable tout ce qu’il sait faire », mais si on le compare avec un animal, une plante, ou même une bactérie, ce n’est rien. Ce que sait faire le vivant, c’est bien plus impressionnant. On a perdu cet émerveillement. Je crois que l’état d’esprit actuel, qui dévalorise la nature et met en avant la technologie, est en partie responsable de la crise de la biodiversité actuelle. À l’occasion de mes cours au Collège de France, je voudrais proposer de nouvelles pistes pour penser le vivant. J’espère que ces pistes pourront aider à résoudre les défis environnementaux d’aujourd’hui.
Virginie Courtier-Orgogozo donnera sa leçon inaugurale, « Penser le vivant autrement », le 9 février au Collège de France, Paris 5e....
Pas encore abonné(e) ?
Voir nos offresLa suite est reservée aux abonné(e)s
Déjà abonné(e) ? connectez-vous !