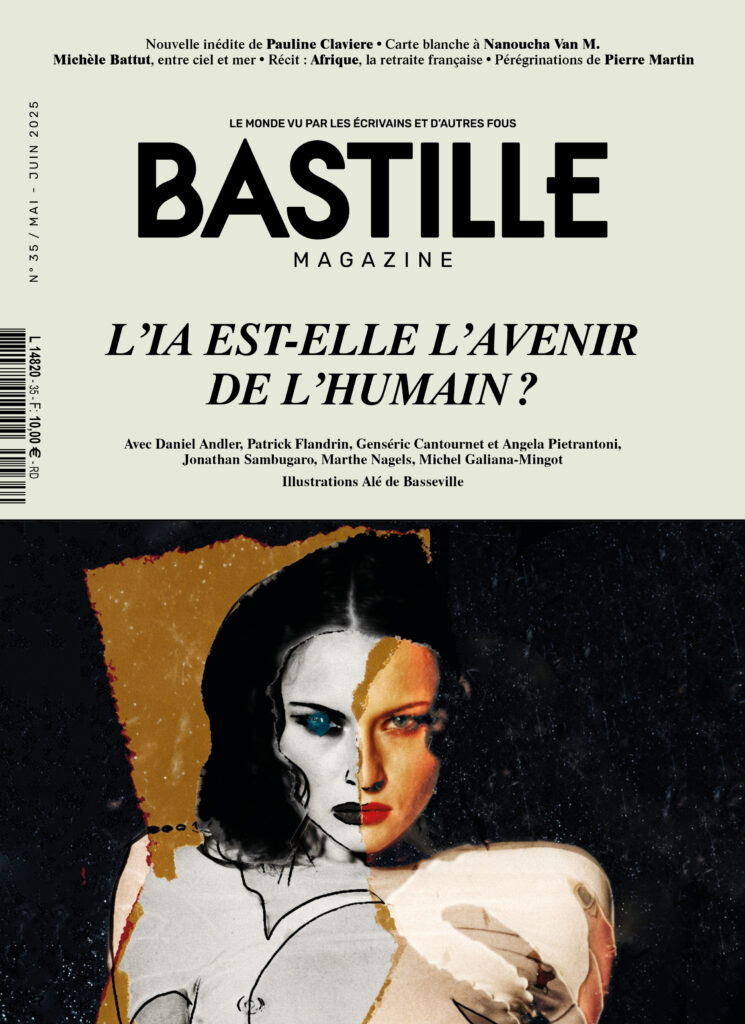« Les anciens sont quelquefois bien bizarres, les têtes grecques n’étaient apparemment pas faites comme les têtes françaises ». De ce constat fait en 1866, Henri Weil (1818-1909) a su tirer les implications philologiques générales : quatre siècles d’étude de la littérature antique n’ont pas permis de faire de celle-ci un domaine connu ; un poète comme Eschyle demeure un véritable mystère, et pour parvenir à la compréhension d’une littérature si étrangère, les philologues doivent reconnaître l’altérité radicale de l’Antiquité grecque, et se débarrasser des préjugés accumulés par leurs prédécesseurs, trop enclins à assimiler anachroniquement le monde ancien au moderne et sa poésie à la nôtre. Telle est l’analyse qui, au cours d’une vingtaine d’écrits publiés entre 1844 et 1909, a permis à Henri Weil de résoudre, dans « La fable de Prométhée dans Eschyle » (1886), l’un des problèmes les plus importants posés par la littérature antique : comment Eschyle dont on reconnaît unanimement la profonde piété et la dévotion pour celui qu’il appelle « le Seigneur, bienheureux entre tous les bienheureux, puissant au-dessus de tous les puissants », a-t-il pu présenter Zeus comme un bourreau, et engager ses auditeurs et ses futurs lecteurs à prendre parti pour sa victime, le Titan Prométhée ? Nous prenons parti pour Prométhée contre Zeus, pour la victime contre le bourreau ; mais est-ce bien là le sentiment qu'Eschyle voulait nous inspirer ? « On peut se demander, écrivait-il en 1886, si notre point de vue est le point de vue d’Eschyle, si l’impression que reçoivent la plupart des…
Allumer le feu
Frantz Olivié