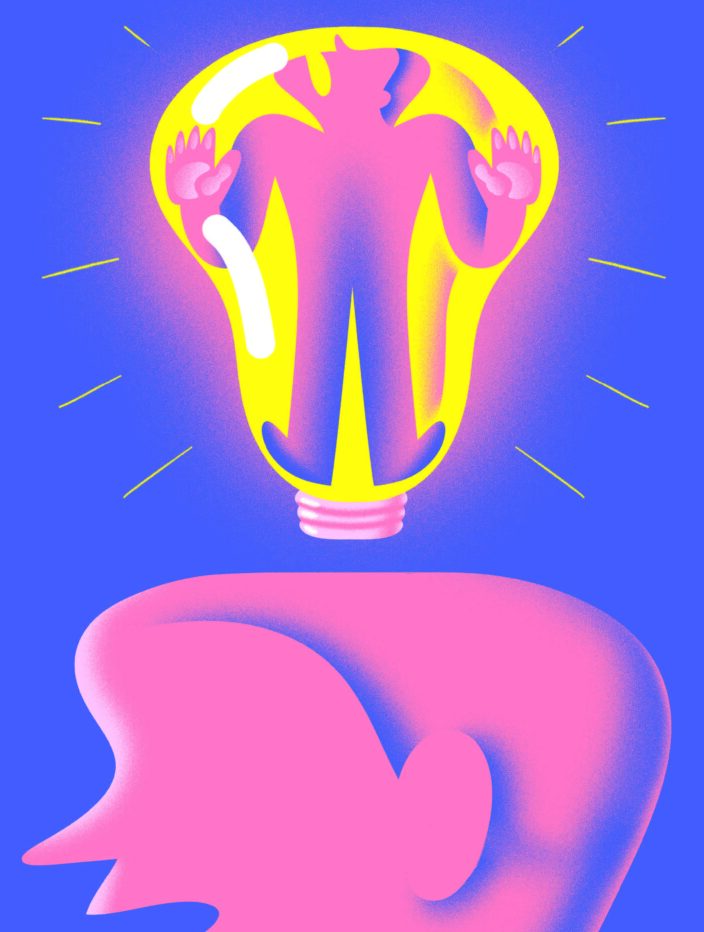L’innovation technologique, susceptible d’être utilisée à mauvais escient et d’échapper à l’éthique, doit trouver des limites. Idéalement, l’esprit même du créateur devrait être cultivé de sorte que ses idées soient bénéfiques à l’humanité.
Dans l’un de ses ouvrages majeurs, Le Système technicien (1977), l’historien du droit, sociologue et théologien protestant libertaire Jacques Ellul dresse une analyse critique approfondie de la place centrale qu’occupe la technologie dans la société contemporaine. Il expose de manière rigoureuse et méthodique les mécanismes par lesquels elle s’est imposée en tant que système autonome ayant des conséquences profondes sur tous les aspects de la vie humaine. Il en tire la conclusion que « s’il y a société du spectacle c’est à cause de, grâce à, en vue de la technicisation. C’est le moyen technique qui permet cette globalisation du spectacle ». Ce qu’il sous-entend ici c’est que la technique est le moyen de la superficialité, de l’étalement et du sommaire. Autrement dit, ce qu’elle permet, c’est du futile, de la frivolité. Des smartphones pliables qui s’invitent dans nos poches aux SUV omniprésents dans les centres-villes en passant par les montres connectées greffées sur les poignets des sportifs comme des cadres se hâtant d’aller retrouver le fauteuil de leur bureau, ce spectacle de l’innovation pourrait être regardé avec un peu d’humour, parfois un peu de détachement, si tout cela n’avait pas des conséquences dramatiques.
Du fait des innovations, des populations et espèces animales disparaissent. L’urbanisation grandissante modifie de manière durable, voire irréversible, les équilibres de la biosphère. Le développement massif des technologies, les biens de consommation – courante ou non – qu’elle permet d’imaginer et de produire ont une conséquence directe sur l’épuisement des ressources naturelles. Sans conteste, il y a une dégradation de l’atmosphère, des sols, des océans à cause de l’activité humaine, de la recherche permanente de croissance économique. Et ces enjeux sont mondiaux : les pluies acides, les pollutions radioactives sont sans frontières et le « 7e continent » fait de plastique dérive dans le Pacifique, hors des eaux nationales. Ces dommages planétaires résultent de l’imprévisibilité de l’effet à terme des innovations que l’on peut introduire sur un marché. Lorsque les chlorofluorocarbures (CFC) sont devenues courantes, dans les années 1950, rien ne permettait de prédire que, dans les années 1970-1980, nous découvririons qu’elles étaient de redoutables gaz à effet de serre et détruisaient l’ozone stratosphérique. Autrement dit, au-delà du spectacle de l’innovation, la question fondamentale est : l’innovation jusqu’où ?
L’environnement, mais aussi la politique et l’individu sont directement affectés par l’innovation. Pour le dire de manière plus brutale, le coupable de la destruction de l’environnement c’est l’innovation ; les dérives politiques que l’on peut dénoncer s’appuient sur l’innovation ; et si l’homme a toujours voulu être immortel, c’est encore l’innovation qui lui permet d’aller vers cette voie. Ainsi, même si les conséquences sur l’écosystème sont les plus inquiétantes, on ne peut pas négliger l’incidence de l’innovation sur l’action politique et l’avenir de l’être humain. Un monde écologiquement correct peut-il rester tolérable sous le talon de fer de régimes dictatoriaux ? Une planète durable est-elle souhaitable si elle n’est habitée que de clones robotisés ?
Le cas de Singapour permet d’illustrer l’enjeu politique. Ce petit État de 720 kilomètres carrés (un peu moins de sept fois Paris intra-muros) est équipé de plus de 100 000 caméras vidéo et veut doubler ce nombre dans les cinq prochaines années. Chaque caméra est dotée d’un système de reconnaissance faciale qui identifie les individus, citoyen comme simple visiteur pris en photo à son arrivée à l’aéroport. Ainsi tout un chacun est fiché, identifié, tracé de manière très précise en tout point d’un territoire minuscule et parfaitement quadrillé, couvert de tant de caméras qu’il est impossible d’y échapper. Pendant le covid, vous pouviez recevoir chez vous une amende parce qu’une caméra avait repéré que vous ne portiez pas correctement le masque dans les transports. Les conséquences de cette innovation technologique sont politiques : ces caméras, toujours en Asie, sont à la base du système de crédit social. Ce programme lancé par le gouvernement chinois vise à évaluer la fiabilité de ses citoyens, entreprises et entités gouvernementales. Il recueille un large éventail de données, à partir desquelles sont notés le comportement social, économique et personnel. De manière concrète, selon la manière dont vous traversez une rue, sur un passage piéton ou non, en respectant les feux de circulation ou pas, on vous attribuera des points ou, au contraire, on pourra vous en retirer. Un bon score vous permettra d’avoir accès à certains services, un mauvais vous l’interdira.
D’autres utilisations sont tristement connues, comme le repérage des Ouïgours pour connaître leur régularité de pratiques religieuses ou l’identification des manifestants pendant les émeutes de Hong Kong. En France, la loi votée en avril dernier portant sur l’organisation des Jeux olympiques, si elle exclut tout dispositif de reconnaissance faciale, autorise la vidéosurveillance algorithmique, permettant une analyse par l’intelligence artificielle d’événements qualifiés de « suspects ». Tout cela n’a été rendu possible que grâce à l’innovation, les gouvernants n’hésitant pas à intégrer ces nouvelles technologies dans leur arsenal répressif.
Un autre exemple d’usage de l’innovation à des fins politiques est celui du scandale Cambridge Analytica, où les données des utilisateurs de Facebook étaient utilisées pour envoyer des messages politiques ciblés et ainsi manipuler l’opinion, notamment lors de l’élection de Donald Trump aux États-Unis ou du référendum sur le Brexit au Royaume-Uni.
L’environnement, mais aussi la politique et l’individu sont directement affectés par l’innovation.
La volonté de parfaire l’être humain n’est pas nouvelle : depuis l’origine – les mythes en attestent – l’homme cherche à augmenter la puissance et la résistance de son corps, la profondeur et l’agilité de son esprit et, in fine, à atteindre l’immortalité. Dans la période moderne, l’innovation a permis cinq évolutions majeures, cinq stades de la transformation de l’humain. Le plus ancien est la greffe, aujourd’hui maîtrisée pour un nombre toujours croissant d’organes ; le second est le clonage humain pour lequel les expériences se poursuivent, notamment en Corée du Sud, mais sans résultat concluant à ce jour ; le troisième s’intéresse à ce que l’on nomme le « design baby » et prend deux formes : la modification des structures génétiques d’un embryon ou d’un fœtus, par exemple pour bloquer l’expression d’un gène responsable d’une maladie héréditaire – à l’aide de CRISPR-Cas9 – ou le « bébé-médicament », sur lequel on prélèvera des cellules saines destinées au traitement d’un autre enfant qui en a un besoin vital ; le quatrième stade est le transhumanisme, qui s’intéresse aux possibilités d’ajouter à l’humain un mécanisme – un bras, un œil, une jambe… – pour le rendre plus performant ; enfin le dernier stade est tout simplement le remplacement de l’être humain par un certain nombre de technologies, c’est le « point de singularité » comme le nomme Ray Kurzweil.
Enfin l’environnement. Chaque année l’innovation, même lorsqu’elle n’a rien de révolutionnaire, permet la commercialisation de nouveaux produits technologiques. On estime que le volume des ventes de ces téléphones, tablettes, télévisions, radios, ordinateurs, etc. atteindra les 9 milliards de pièces d’ici 2028. Pour chaque unité produite il est nécessaire d’utiliser des matériaux rares et épuisables qui sont extraits à l’aide de procédés polluants (injection d’acide), par une main d’œuvre exploitée dans des conditions extrêmes. Ces objets électroniques, pas toujours recyclables et très rarement recyclés, finissent la plupart du temps sur des plages d’Afrique, comme au Ghana, aux côtés des pyramides de vêtements, vestiges disgracieux des dérives de la fast fashion.
Un autre problème est lié à l’usage d’Internet. Les serveurs émettent chaque année plusieurs centaines de millions de tonnes de CO2. Le streaming joue un rôle de premier plan dans ces émissions : le visionnage de vidéos sur Netflix, Prime, YouTube et consort représente près de 53 % du trafic. Les jeux vidéo de ne sont pas en reste, ils génèrent à eux seuls et sur le territoire des États-Unis uniquement 24 millions de tonnes de CO2, soit autant que plus de 5 millions de voitures.
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme », avait annoncé François Rabelais avec un esprit particulièrement visionnaire dans Pantagruel, en 1532. L’électronique a envahi notre quotidien avec les objets communicants ; la « numérisation du monde » devient un enjeu considérable ; les nanotechnologies sont omniprésentes dans l’alimentation, les vêtements, les meubles, les voitures, etc. Et ce n’est certainement qu’un début, compte tenu des propositions à venir sur le marché du corps, voué à l’optimisation technologique, comme sur celui de l’esprit, incité à sous-traiter ses fonctions historiques – création, raisonnement, mémorisation, expression… – à des intelligences artificielles génératives.
Associées aux moyens de communication modernes, les nouvelles technologies numériques ne sont pourtant pas sans lien avec les avancées démocratiques, permettant de faire connaître des situations politiques complexes et de mobiliser dans des contextes de faible liberté d’expression. Les avancées médicales, permises ou facilitées par la technologie, sont couvertes de louanges par leurs bénéficiaires. Ainsi, la notion d’innovation, comme celle de science, est à mettre en perspective avec le terme grec deinon qui exprime à la fois le terrible et l’admirable, lesquels se télescopent pour dire la puissance des contraires. À l’image de l’homme qui dispose, affirme Sophocle dans Antigone, « de ressources dont l’ingénieuse habileté dépasse toute espérance, il s’avance tantôt vers le mal tantôt vers le bien ». Or c’est bien l’homme, l’individu qui innove, c’est bien lui qui peut faire pencher une innovation d’un côté ou de l’autre, vers le mal, ou le bien, de façon consciente ou non. Désormais, le problème n’est plus la capacité scientifique, il est dans le choix éthique. Faire ou ne pas faire, telle est la question. Qui décide et au nom de quelles valeurs ? En pratique, la réponse est rarement évidente. Parmi de très nombreuses situations, la naissance, en 2012, du premier « bébé-médicament » résume la problématique. Les parents d’une petite fille atteinte d’une maladie génétique ont décidé d’avoir un nouvel enfant permettant de la sauver. Pour ce faire, il a fallu procéder à un double diagnostic : écarter les embryons porteurs de la maladie et sélectionner, parmi les embryons sains, le plus compatible avec le patrimoine génétique de la grande sœur, avant de l’implanter dans le ventre de la mère. Si l’on peut saluer la prouesse technique on peut s’interroger sur les conséquences d’une telle réussite qui confine à l’eugénisme.
Qui participe au spectacle de l’innovation que dénonçait Jacques Ellul ? Car si l’innovation est l’objet de toutes les critiques, n’est-ce pas l’innovateur qui est concerné au premier chef ? Certes l’acheteur du dernier smartphone, du dernier SUV ou de la dernière montre connectée aime se donner en spectacle grâce à l’innovation acquise. Toutefois l’acteur numéro un du spectacle est à l’évidence l’innovateur. C’est lui qui fait, qui œuvre, qui met en scène.
Désormais, le problème n’est plus la capacité scientifique, il est dans le choix éthique.
Se déporter du penser de l’innovation vers le penser de l’innovateur paraît donc être un élément de déconstruction indispensable, d’autant que, acteur du monde, l’innovateur a le pouvoir de le diriger. Qui songe à contester qu’aujourd’hui les réseaux sociaux reconfigurent le monde, orientent les opinions, déterminent certains choix, des plus quotidiens jusqu’à ceux qui engagent l’avenir démocratique de nos sociétés ? Pourtant il semble, pour prendre cet exemple, qu’en créant Facebook Mark Zuckerberg ait essentiellement conçu cette application pour permettre à ses utilisateurs d’interagir avec d’autres. La possibilité technique de démultiplier un type d’interaction humaine semble avoir servi de cadre suffisant pour le penser de cette innovation. Ce n’est qu’a posteriori, et sous la pression de certains éléments du corps social, qu’ont surgi des interrogations allant au-delà du service rendu par ce réseau :
la première porte évidemment sur l’usage des données que Facebook – et tous les autres architectes du big data – peut collecter. Que cette accumulation de données puisse, à plus ou moins longue échéance, avoir quelques effets bénéfiques, c’est probable, mais dans quelle mesure ne sont-elles pas néfastes ici et maintenant ? Au fil du temps, des questions incidentes ont pu émerger : n’aurait-il pas été possible de créer ce réseau avec des partenaires institutionnels, des ONG, par exemple, afin que ce service ne soit pas la propriété d’un individu ou d’un groupe, mais d’un collectif responsable n’ayant pas le profit pour seul horizon ? Qu’aurait perdu M. Zuckerberg à solliciter les points de vue d’un grand nombre de parties prenantes, directes ou indirectes, pour recueillir leurs impressions, leurs désirs mais aussi leurs craintes ? En procédant ainsi, il se serait dégagé du process, vu uniquement en termes d’efficacité et à court terme, pour aller à l’essence même du service qu’il entendait proposer. Il se serait en quelque sorte engagé dans une phénoménologie de son innovation qui aurait pu modifier la conception même du réseau social qu’il entendait mettre sur pied. Au sens où la démarche phénoménologique telle que la définit Husserl dans l’introduction des Recherches logiques implique « le retour aux choses mêmes » et où intuitions et impressions peuvent constituer des sources pour la connaissance. La phénoménologie comme l’innovation cherchent de nouveaux cadres de référence, ouvrent des perspectives nous permettant de nous mettre à la place d’autrui et proposent des solutions originales, inédites, qui ne sont pas simplement une répétition des usages communs et habituels.
De la même manière, lorsqu’en novembre 2018 un chercheur chinois a affirmé avoir mené à terme une grossesse gémellaire portant sur des embryons dont le génome avait été édité, a-t-il un instant suspendu son désir d’action pour prendre toute la mesure de ce « progrès » technique ? A-t-il momentanément mis en suspens cette « faculté de fabriquer les objets artificiels, en particulier des outils à faire des outils, et d’en varier indéfiniment la fabrication » dans laquelle Henri Bergson, dans L’Évolution créatrice, fait résider l’intelligence proprement humaine ? A-t-il un instant échappé au sentiment de toute-puissance issu de cette découverte, résisté à ce désir ou sollicité de multiples points de vue pour évaluer les gains réels ainsi engrangés pour l’humanité ?
L’innovateur du XXIe siècle ne peut guère s’exonérer de questionnements philosophiques en se cantonnant soit dans la seule conception technique, soit dans des ajustements marginaux de son action, imposés par quelques barrières éthiques ou cadres législatifs opportunément élevés mais souvent a posteriori. En effet les lois, les obligations, les règles sont court-termistes et l’innovation venant toujours avant la loi, cette dernière courra toujours après de mauvaises pratiques. C’est pourquoi l’origine de cette situation est à chercher à la racine, dans la personnalité de l’innovateur, c’est à elle qu’il faut s’attaquer, et veiller à faire naître un innovateur philosophe.
Philosophe, professeur à l’Essec, directeur du centre iMagination et directeur de programme au Collège international de philosophie, Xavier Pavie est notamment l’auteur de L’Innovation à l’épreuve de la philosophie (éd. PUF) qui a reçu le prix du meilleur ouvrage de management 2019....
Pas encore abonné(e) ?
Voir nos offresLa suite est reservée aux abonné(e)s
Déjà abonné(e) ? connectez-vous !