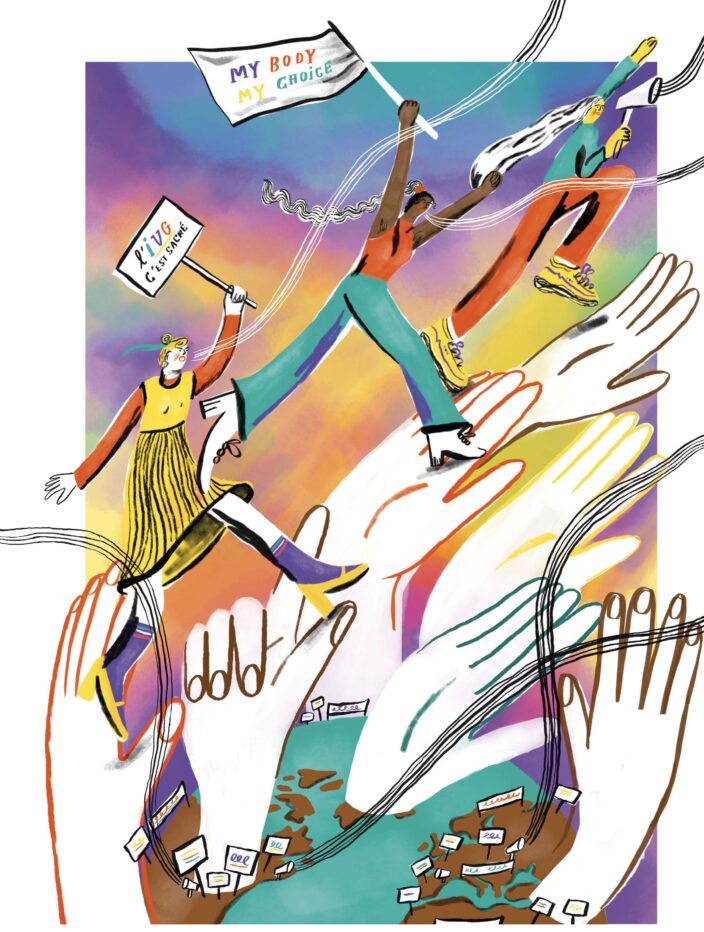Alors que la France envisage d’inscrire le recours à l’IVG dans sa Constitution, l’accès à ce soin relève du calvaire dans de nombreux pays. Récits de Madagascar, du Japon et du Texas.
Une allée fleurie, une maison perchée sur une colline d’un quartier de l’est d’Antananarivo: Aïna*, 29 ans, se confie. Il y a cinq ans, alors jeune mariée et enceinte, elle apprend que le fœtus souffre d’une malformation grave et ne sera pas viable. Elle et son époux consultent trois gynécologues avant de décider d’une ITG, interruption thérapeutique de grossesse. L’intervention est pratiquée dans une clinique, en toute sécurité. Lors d’une rencontre fortuite, elle apprend que l’opération qu’elle a subie est illégale. Madagascar fait en effet partie des pays ayant les lois les plus restrictives au monde en matière d’avortement puisqu’il est interdit dans tous les cas. Sans exception. Les textes répressifs ont même été renforcés en 2017, ajoutant des sanctions pénales. Aïna l’ignorait. «Il y a encore six ans, c’était un sujet tabou», dit-elle. La maison dans laquelle nous la rencontrons abrite le siège de l’association malgache Nifin’Akanga, dont l’un des objectifs est de faire autoriser l’ITG. La jeune femme a rejoint l’ONG après avoir rencontré une des cofondatrices. Elle y découvre la réalité des avortements illégaux pratiqués en dehors d’une enceinte médicalisée, avec des méthodes peu fiables et dangereuses. Le nom de l’association est d’ailleurs celui d’une plante abortive dont se servent certaines matrones dans les villages, avec des conséquences parfois mortelles. Nifin’Akanga, qui compte sept antennes réparties dans le pays, a recueilli des dizaines de témoignages, compilés dans un «livre noir».
Vania*, elle, vit et travaille comme femme de ménage au sein d’une famille dans la région de Toamasina, sur la côte est de Madagascar. Violée par le fils de son employeur, elle est sommée par celui-ci d’avorter. Elle sait que c’est illégal. Elle a peur. Elle se rend chez une matrone qui pratique les massages abortifs. Elle saignera pendant deux semaines, sauvée de justesse de l’infection par une femme qui lui procure des antibiotiques.
Forcément clandestins, les avortements sur l’île sont difficilement dénombrables. D’après une enquête de l’Institut Pasteur de Madagascar en 2015 et 2016, sur les 3063 femmes en âge de procréer qui y ont répondu, 33% déclaraient avoir vécu au moins un avortement (spontané ou provoqué) durant leur vie, 13%, au moins un provoqué dans les dix dernières années précédant l’étude.
Avec 392 décès pour 100000 naissances vivantes en 2020, selon la Banque mondiale, Madagascar a également l’un des taux de mortalité maternelle les plus élevés du monde. Pour protéger les femmes et les médecins, Nifin’Akanga, l’ordre des médecins, des juristes et une députée ont déposé un projet de loi en 2021 afin de légaliser l’ITG. Mais celui-ci n’a jamais vu la couleur d’une séance plénière, retiré de l’ordre du jour par la présidente de l’Assemblée nationale malgache, Christine Razanamahasoa. Il végète depuis dans les oubliettes de la chambre basse. Pourtant, en 2003, le pays a signé le Protocole de Maputo, qui l’engage à prendre «toutes les mesures appropriées pour protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l’avortement médicalisé».
Il fait chaud dans le taxi qui tente de rejoindre le centre de la capitale, au milieu des embouteillages. La vieille Renault 4 beige, rouillée, dégage une forte odeur d’essence et les fenêtre peinent à s’ouvrir. Nous passons derrière des immeubles tout neufs, un raccourci à l’arrière d’un quartier en construction. Le long du chemin, des habitations rudimentaires s’entassent. Des femmes lavent le linge dans le canal adjacent. L’eau est sale. L’image d’un pays où 81% de la population vit avec moins de deux euros par jour.
«Avorter au quartier peut tuer mais nous le faisons parce que nous n’avons pas d’argent pour aller dans les grandes cliniques privées», raconte Mlle C.*, enceinte de son père, qui la violait régulièrement depuis deux ans. Dans un pays où la part mensuelle de PIB par habitant est d’à peine plus de 40 euros, Aïna* a payé son intervention 300000 ariary (environ 60 euros) dans une clinique privée. Vania a dû attendre deux mois pour réunir avec son seul salaire les 30000 ariary (6 euros), demandés par la matrone. Mlle C. avait 15 ans et pas d’argent: elle a cueilli les feuilles d’une plante qu’elle ne connaissait pas, dans la brousse, avec l’aide d’une amie.
C’est pour en finir avec la culture de la honte que Nifin’Akanga a fait de la communication sa première mission: tracts de sensibilisation aux malformations fœtales, aux dangers de certaines grossesses, aux viols et à l’inceste, actions dans tout le pays, présence dans les quartiers... Après six années d’actions, ses arguments commencent à être entendus. Une feuille de route en 40 points, à destination des pouvoirs politiques, a été rédigée. «La colère contre l’injustice est un bon moteur», estime Kemba Ranavela, présidente et cofondatrice de l’association. Mais le chantier pour un droit à la santé et à la dignité est immense. Et l’information sur la santé sexuelle et reproductive très lacunaire. «Peu de femmes prennent la pilule, même les plus éduquées. Culturellement, il y a une méfiance envers l’allopathie», relate la présidente. De leur côté, les pouvoirs publics sont fermement opposés à l’éducation sexuelle. Une note de novembre 2023 du ministère de l’Éducation interdit ainsi «de mener des démonstrations véhiculant l’utilisation des matériels et/ou méthodes contraceptives, y compris les préservatifs, dans l’enceinte des établissements scolaires», préconisant même qu’en cas d’activités relatives à l’éducation sexuelle, elles «doivent être mises en œuvre dans le respect du principe du ministère, à savoir l’ABSTINENCE» [en capitales dans le texte].
Pour Kemba Ranavela, le combat politique passe aussi par le fait de convaincre les femmes «qu’elles valent quelque chose dans un pays où la culture du viol fait rage, où le pouvoir passe avant la sororité». Alors que la nuit tombe sur la terrasse où elle nous reçoit, dans un quartier central de la capitale, elle conclut: «Nous irons jusqu’au bout, même en prison s’il le faut.»
De fait, leurs actions ne se font pas sans heurts. Les militants de Nifin’Akanga ne sont-ils pas appelés mpamono olona, les «meurtriers»? Leurs réseaux sociaux sont inondés de messages de haine, depuis le dépôt du projet de loi en 2021. Les prêtres du pays se sont réunis en conclave spécial pour débattre du sujet, et le condamner. Cette période a été très difficile pour les membres de l’association et pour leurs familles, qui ne comprennent pas toujours leur combat. Les sanctions pénales font également peur aux femmes. «J’ai failli mourir en me faisant avorter, raconte Vania, la jeune femme de Toamasina. Si je n’avais pas peur de le faire dans un centre de sante, peut-être que je n’aurais pas autant saigne.»
À quelques milliers de kilomètres et quelques heures de décalage horaire, au Japon, Kumi Tsukahara se bat pour la même cause. À 63 ans, la chercheuse, docteure en philosophie, a dédié une grande partie de sa vie à défendre et à faire avancer les droits des femmes, dont celui de l’avortement. Derrière son bureau à Kanazawa, sur la côte nord-ouest de l’île, elle cherche les bons mots en anglais, aidée parfois d’un logiciel de traduction, pour raconter la complexité du sujet dans son pays. Lorsqu’elle est tombée enceinte pour la première fois, elle a 21 ans et son compagnon est alors encore étudiant. Le couple n’est pas marié. L’avortement semble alors l’option la plus raisonnable, même si ce n’est pas son souhait. Elle culpabilisera longtemps, en particulier après une fausse couche quelques années plus tard, mais s’aperçoit rapidement que le problème se situe ailleurs. «Je me suis rendu compte que, faute d’éducation sexuelle appropriée, nous ne comprenions pas les méthodes de contraception et que celles-ci étaient très limitées. À partir de là, j’ai pris conscience du problème de l’avortement au Japon.»
Faute d’IVG, des femmes choisissent parfois de se donner la mort, emportant le bébé avec elles. Ou le maltraitent.
Si l’IVG y est illégale mais autorisée sous certaines conditions depuis 1948, la législation japonaise a été modifiée plusieurs fois depuis. À l’heure actuelle, elle est seulement possible en cas de viol ou de risque pour la santé physique ou économique. Le consentement marital écrit est requis. Ce dernier point n’a jamais été modifié depuis plus de soixante-quinze ans mais l’usage et la peur de poursuites judiciaires ont incité les médecins à étendre cette demande de consentement aux partenaires des femmes célibataires.
Pour la chercheuse, avoir l’accord de son compagnon n’a pas été un problème. Mais pour de nombreuses femmes, l’obtention du consentement écrit s’avère impossible. Elles doivent alors mener à terme la grossesse. Certaines finissent même par abandonner leur enfant. Yuko*, 35 ans, avait ainsi spécifié à son compagnon avant leur mariage qu’elle n’en voulait pas. Il y a quatre ans, après la naissance, son mari devient violent. Elle décide de partir, laissant sans regrets l’enfant à son père. Des femmes choisissent parfois même de se donner la mort, emportant le bébé avec elles. Ou le maltraitent. Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, 50 enfants maltraités sont décédés, 24 décès sont dus à un double suicide de la mère et de l’enfant, 15 ont été abandonnés pendant la période périnatale, 7 d’entre eux sont décédés.
Au consentement s’ajoute le coût. De 100000 à 150000 yens (630 à 1000 euros), c’est le prix d’une intervention par curetage ou aspiration au Japon. La pilule abortive, disponible depuis mai 2023, revient à plus de 600 euros avec la consultation. Quelle que soit la méthode, aucune n’est remboursée par la sécurité sociale. Le salaire minimum au Japon variant entre 1180 euros et 1471 euros brut, selon les régions. Une partie des femmes se fourniraient en comprimés sur Internet, contournant par ce biais le coût et le consentement requis.
Sur X, Kumi Tsukahara reçoit elle aussi souvent des messages de haine, qu’elle ignore. «J’essaie toujours de fonder mes déclarations sur des données, en tant que chercheuse. Ainsi, je suis moins susceptible d’être victime de la haine émotionnelle.» Si elle se sent parfois frustrée, elle ne s’est jamais laissée intimider. Elle a à cœur d’informer les Japonais, qui le sont trop peu selon une étude Ipsos de 2018, sur les droits humains, lesquels «sont présentés par le ministère de la Justice comme s’il s’agissait de compassion et non d’une obligation incombant à l’État». Elle a cocréé, Action for Safe Abortion Japan en 2020. L’association, aidée d’avocats, soutient actuellement l’action en justice d’une jeune femme qui porte plainte contre l’État japonais dans le but de faire abolir le principe du consentement écrit. Elle écrit actuellement son troisième livre sur l’avortement, destiné au grand public et qui sortira à l’automne.
L’église aide les femmes qui n’en ont pas les moyens à aller avorter hors du Texas.
Changement de continent et de décor: une église d’un quartier résidentiel arboré du nord de Dallas, au Texas. Le 24 juin 2022, la First Unitarian Church of Dallas. Le révérend Daniel Kanter, 56 ans, prend la parole lors d’un service spécial: «Nous sommes dans cette église parce que c’est ici que l’affaire Roe v. Wade a commencé en 1970, portée par l’alliance de femmes de la paroisse.» Ce jour-là, la Cour suprême américaine a rendu une décision, connue sous le nom de «Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization», invalidant celle de 1973, qui garantissait aux femmes le choix de continuer ou non leur grossesse, laissant à chaque État le soin de légiférer. Le Texas a déjà voté, en 2021, la limitation à six semaines sauf en cas de danger pour la mère.
L’église est un bâtiment moderne, fermé en ce jour de semaine. Les bureaux sont situés de l’autre côté du jardin. Le révérend nous accueille chaleureusement, tenue décontractée, une tasse de ce qui semble être du café à la main. Daniel Kanter dirige depuis 2009 cette communauté progressiste, multiconfessionnelle et inclusive, qui aidait déjà, bien avant la légalisation de 1973, les femmes à avorter. Depuis son arrivée à Dallas, en 2001, le révérend multiplie les actions en faveur des femmes.
Il y a huit ans, il est convié par le Southwestern Womens Surgery Center, une clinique pratiquant les avortements, située dans la banlieue nord de la ville, à bénir une de leurs patientes avant son intervention. Il propose alors à l’équipe médicale de créer une aumônerie à la clinique. «Nous avons mis en place un groupe d’aumôniers bénévoles issus de sept ou huit confessions (méthodiste, unitarienne, disciple du Christ, juive...), présents six heures par mois pour accompagner les patients, les bénir, répondre aux questions sur les sujets religieux et être un visage amical de la religion à l’intérieur, tandis que les manifestants hurlaient sur les patients à propos de sujets religieux à l’extérieur.» Pour lui, avoir la foi et soutenir les femmes désireuses de mettre un terme à leur grossesse n’est pas incompatible. «Chaque être humain est aimé de Dieu, quoiqu’il arrive. En tant que croyants, nous devons contrer le discours selon lequel tous les croyants sont opposés à l’avortement.»
Dès décembre 2021, plusieurs centres ayant déjà fermé, le révérend Kanter et sa paroisse ont mis en place le Travel Program, proposant aux femmes dont les ressources se situent en dessous du seuil de pauvreté de pouvoir se rendre en avion à Albuquerque, au Nouveau-Mexique voisin. Après un arrêt de six mois entre juin et octobre 2022, le temps de trouver un moyen de contourner la récente loi, les voyages ont repris. Une dizaine de femmes en bénéficient chaque semaine, les trajets sont entièrement financés par l’église. «Nous espérons augmenter ce chiffre en faisant connaître le programme.»
Au premier étage du bâtiment, dans son agréable bureau où nous nous sommes installés, le révérend est heureux d’annoncer l’avancée d’un nouveau projet. Au printemps prochain ouvrira à Dallas le Truth Pregnancy Resources Center. Ce centre sera doté de matériel médical. Le personnel pourra dater la grossesse, proposer toutes les options et l’aide nécessaire: mener la grossesse à terme, faire adopter l’enfant ou se faire avorter. Les femmes auront le choix et seront accompagnées par l’église. Avec ce nouveau lieu, il espère contrer les faux centres qui pullulent en ville, où tout est fait pour dissuader d’avorter: images horribles diffusées, culpabilisation… Et pouvoir faire bénéficier à plus de femmes des voyages hebdomadaires à la clinique d’Albuquerque.
«Les personnes qui sont le plus affectées ne sont pas vues. Ils ne s’intéressent pas aux femmes!» déplore le révérend texan. Le Southwestern Center permettait à plus de 600 femmes par semaine de pouvoir se faire avorter. Si 10 se rendent au Nouveau-Mexique grâce à l’église toutes les semaines, les 590 autres qui allaient à la clinique, dont les portes ont fermé en mars 2023, se retrouvent seules face à leur grossesse non désirée.
Une intervention, c’est 450 à 600 dollars (415 à 550 euros) selon les endroits. Le salaire horaire minimum aux États-Unis, 7,25 dollars (6,70 euros). S’ajoute le coût du voyage en dehors de l’État. Pour dissuader certaines candidates, plusieurs villes texanes ont voté des lois interdisant aux gens d’utiliser les routes de la ville pour transporter des femmes enceintes cherchant à avorter dans d’autres États. Concrètement, c’est impossible à vérifier, dit le révérend, c’est juste pour leur faire peur.
La pilule abortive, plus facile d’accès, représente 53% des avortements dans tout le pays, selon l’Institut Guttmacher. Elle est également menacée d’interdiction. La Cour suprême doit statuer sur son sort d’ici juin 2024. Sur la totalité des nouvelles grossesses au Texas, depuis que les IVG y sont soumises à de nouvelles restrictions, plus de 26000 se sont avérées consécutives à des viols, selon une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association.
Les prises de positions de Daniel Kanter lui valent d’être considéré comme le «diable» par de nombreux représentants d’autres cultes religieux, opposés à l’avortement. Lorsqu’il a médiatisé son Travel Program, il a reçu tellement de messages violents et de menaces qu’il a été contraint d’installer des caméras devant son domicile. Est-ce la foi qui le protège, même s’il admet dans ses sermons être parfois en colère? Le révérend préfère mettre ce sentiment au service de projets pour aider plutôt que de gaspiller cette énergie inutilement. «Il a fallu cinquante ans pour défaire Roe v. Wade, il en faudra encore cinquante pour défaire Dobbs v. Jackson.»
Alors qu’en France, l’inscription du droit à l’IVG dans la Constitution est au cœur du débat législatif, Daniel Kanter, marié à une Française et qui suit la politique hexagonale, prévient: «C’est un avertissement pour des pays comme le vôtre. L’avortement est un sujet émotionnel. Marine Le Pen s’en servira pour remporter la victoire, je vous le garantis. Trump était favorable à l’avortement avant de rejoindre le Parti républicain et de se présenter à l’élection présidentielle.»
* Les noms ont été changés.
...
Pas encore abonné(e) ?
Voir nos offresLa suite est reservée aux abonné(e)s
Déjà abonné(e) ? connectez-vous !