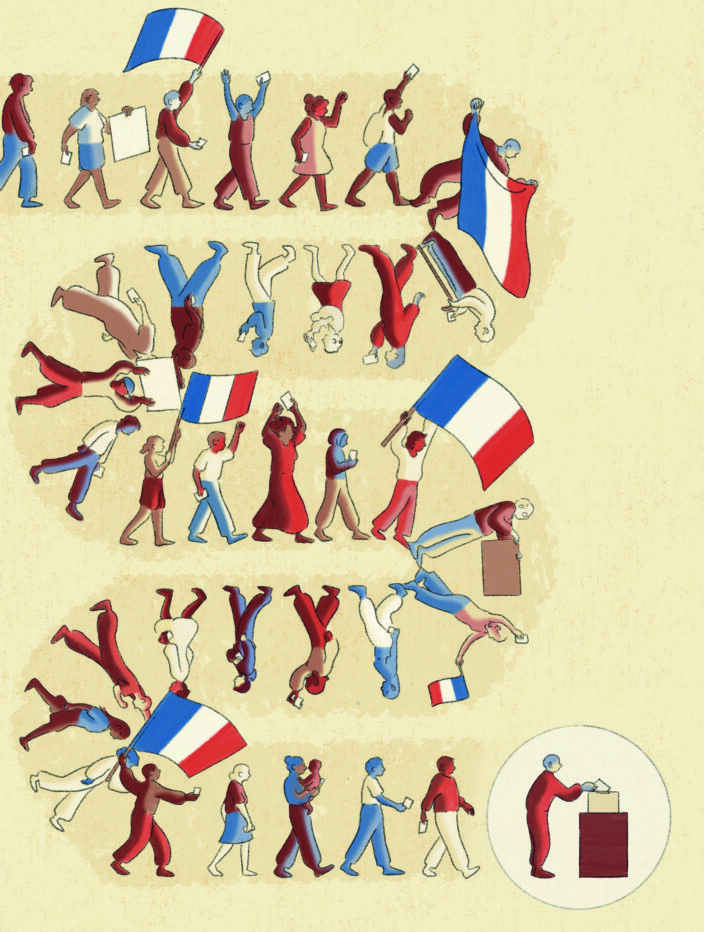Il n’y a pas de réponse au malaise de la démocratie si l’on n’offre pas aux citoyens la possibilité non seulement d’élire leurs représentants, mais aussi de se présenter eux-mêmes à des fonctions électives.
Concept ancien, voire antique, la démocratie, lorsqu’elle s’est imposée comme principe et méthode de gouvernement, ne l’a fait que bien plus tard que nous le pensons souvent. Nous oublions volontiers, par exemple, que dans la plupart des pays qui s’en réclament, le suffrage universel n’est la règle que depuis moins d’un siècle. En France, les femmes n’ont obtenu le droit de vote qu’en 1944. Et, en Suisse, en 1971 seulement. Chez les hommes, certaines catégories comme les domestiques et les allocataires sociaux en ont été longtemps privés. C’est sans doute le caractère récent de l’adoption de ce système qui explique que nous en sachions encore si peu sur la théorie et la pratique de la démocratie et, plus particulièrement, sur la manière de la financer et d’organiser son fonctionnement dans une société où la plupart des citoyens travaillent ou s’occupent de leurs proches et manquent de temps pour s’impliquer dans le gouvernement de la cité.
La démocratie représentative, comme l’a suggéré Joseph Schumpeter, est une partie de la réponse à ces problèmes. Toutefois, l’idée que l’économiste et politiste, né dans l’empire austro-hongrois, se faisait de l’élu politique était celle d’une profession spécialisée que très peu de gens peuvent légitimement prétendre exercer – de sorte que le métier de politicien est vu un peu comme celui de chirurgien cardiaque, exigeant des années de formation et des connaissances inaccessibles au plus grand nombre. Une telle vision soulève inévitablement la question de savoir si la démocratie électorale peut être autre chose qu’une oligarchie où les membres d’une élite constituée en caste endogène est régulièrement portée au pouvoir lors de rituels qui s’apparentent à des simulacres.
C’est de notre difficulté à associer l’ensemble des citoyens à l’élaboration comme à l’application d’une politique démocratique que naissent la désillusion, la frustration et la colère qui se manifestent dans les démocraties établies comme dans les plus récentes. La promesse première de la démocratie, inscrite dans son étymologie, est d’être un gouvernement par le peuple et pas seulement pour lui, car il ne sera pas toujours pour nous s’il n’est pas aussi par nous. Non seulement parce que le pouvoir corrompt, mais aussi parce que, sans moyens institutionnalisés pour alerter nos dirigeants sur nos difficultés, nos besoins et nos aspirations, sans contrôle sur la traduction de ces informations en action gouvernementale, la pression des événements fait qu’il est probable qu’elles seront mal comprises ou même ignorées. Ce qui n’est évidemment pas sans conséquences: si nos gouvernements ressemblent davantage à des oligarchies élues, voire à des ploutocraties, qu’à des démocraties, il n’est pas surprenant que les citoyens se sentent mal gouvernés, instrumentalisés ou ignorés, et que même ceux qui sont les moins mal lotis aient l’impression d’être traités avec condescendance, méprisés, voire humiliés.
Que faire?
Faudrait-il renoncer à la démocratie au motif qu’elle suscite des espoirs chimériques qui compromettent toute perspective de gouvernement efficace et stable?
Compléter ou remplacer la démocratie électorale par une combinaison de formes de participation plus directes, telles que les référendums? Renoncer aux rituels rendez-vous électoraux à date fixe au profit de consultations électroniques continues? Multiplier les «assemblées citoyennes» composées d’individus sélectionnés de manière aléatoire?
La première de ces options ne semble pas particulièrement attrayante, les modes de gouvernement alternatifs expérimentés au cours de l’histoire, ou actuellement en exercice de par le monde, peinant à convaincre. Les autres, si elles ont l’attrait de la nouveauté, soulèvent inévitablement des questions délicates en matière de légitimité et d’objectivité.
Notre intuition est qu’il n’y a pas de réponse au malaise de la démocratie contemporaine si l’on ne se préoccupe pas de la possibilité pour les citoyens, non seulement d’élire leurs représentants, mais aussi de se présenter eux-mêmes à des fonctions électives, tant nationales que locales. Cette intuition peut paraître surprenante pour ceux qui sont conscients et préoccupés par la réticence croissante des citoyens à participer élections – un sujet qui retient régulièrement l’attention et suscite des cris d’angoisse dans les médias alors que l’incapacité des citoyens à se présenter comme candidats aux élections passe pratiquement inaperçue. Pourtant, la corrélation est évidente. Ceux qui ne voient pas l’intérêt de voter peuvent tout simplement avoir du mal à identifier l’intérêt démocratique de choisir parmi des candidats dont l’origine sociale, la profession et les expériences sont très éloignées des leurs comme de celles de leur entourage immédiat. Si l’intérêt de la démocratie est de pouvoir influencer la manière dont nous sommes gouvernés, la distance, énorme, qui sépare la plupart des politiciens professionnels de leurs concitoyens fait qu’il semble très improbable que le fait de voter pour l’un d’entre eux plutôt que pour un autre produise un résultat différent. Notre conviction est qu’il serait manifestement plus facile de distinguer les élections démocratiques des élections non démocratiques si davantage de citoyens pouvaient envisager sérieusement d’être candidats, au lieu de de considérer cette éventualité aussi probable qu’un voyage sur la Lune.
Que faut-il changer pour que la démocratie électorale n’apparaisse plus comme une promesse trompeuse, voire une contradiction dans les termes? Sans remettre en question le concept, on peut imaginer différents ajustements, gardant à l’esprit qu’aucun n’est suffisant et que tous sont susceptibles d’être controversés. Le premier consiste à considérer le travail de représentant élu comme un travail de groupe, partagé entre deux ou plusieurs personnes; le deuxième à faciliter la candidature de personnes politiquement indépendantes, sans affiliation à un parti; le troisième à envisager des sites plus décentralisés pour l’élaboration de la loi, ainsi que la possibilité d’un recours accru au travail à distance ou hybride; enfin, le dernier consisterait à concentrer la semaine de travail sur quatre jours – conformément aux expériences récentes, largement prometteuses – pour permettre aux actifs de disposer du temps nécessaire à l’étude des problèmes de la cité.
Il est clair que ces options ne s’excluent pas mutuellement et que l’on peut s’attendre à ce qu’elles fonctionnent mieux lorsqu’elles sont combinées. Par ailleurs, il est tout aussi probable qu’elles se heurteront à toutes sortes de résistances, alors même que certaines d’entre elles n’exigeraient que des aménagements relativement modestes dans le fonctionnement de nos institutions. L’intérêt de les esquisser ici est d’illustrer les façons dont nous pourrions essayer d’améliorer la théorie et la pratique de la démocratie – à l’évidence imparfaites – la seule alternative, nébuleuse, étant de renverser la table pour proposer une forme radicalement nouvelle de gouvernement.
Le partage des tâches et les défis de la représentation contemporaine.
Jusqu’au xxe siècle, dans la plupart des pays, siéger au sein d’un parlement national n’était pas un emploi à plein temps. Non rémunérés, les législateurs devaient et pouvaient consacrer l’essentiel de leur temps à des activités lucratives.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la représentation politique a connu des bouleversements considérables, même si nos assemblées législatives se trouvent toujours dans les mêmes bâtiments et que les protocoles comme les procédures n’ont été que très peu modifiés. Le développement de la fiscalité directe a considérablement accru la collecte d’argent public tandis que la mise en place de l’État providence multipliait les postes de dépenses. Dès lors, les questions budgétaires ont gagné en complexité, les nécessaires arbitrages occasionnant d’interminables débats. Les avènements de l’Internet, des réseaux sociaux et des chaînes d’information en continu ont encore alourdi le fardeau des élus, les contraignant à entreprendre des actions visibles et à en défendre inlassablement la pertinence.
Exigeant toujours plus de compétences et de disponibilité, la politique est ainsi devenue affaire de professionnels rémunérés.
Même si la langue officielle préfère utiliser le terme «indemnisés» – spécialisés dans des domaines très précisément définis. Ainsi s’est imposée l’idée que chaque poste devait être occupé par un individu et un seul, présumé compétent et totalement dévoué à sa fonction. C’est cette évidence qui mérite d’être reconsidérée.
Compte tenu de la complexité du travail – la nécessité pour l’élu de maintenir un contact permanent avec les représentants locaux, d’assurer une présence régulière dans sa circonscription (au moins dans les systèmes électoraux basés sur la représentation géographique), d’entretenir des liens avec son parti politique (à l’intérieur et à l’extérieur du corps législatif), avec les médias et les groupes d’intérêt, les organisations caritatives, les think-tanks, les fonctionnaires et les experts de toutes sortes – le confier à un groupe d’individus plutôt qu’à un seul permettrait à chacun de ne s’y consacrer qu’à temps partiel, ravivant l’attrait de ces fonctions aux yeux de ceux et celles qui ne veulent pas sacrifier toute leur vie professionnelle, voire privée, à la politique. Le partage des tâches (par groupes de deux ou trois, et même plus, comme cela a été tenté au Brésil) pourrait également faciliter la formation sur le tas et éviter un problème souligné dans le livre d’Étienne Ollion (Candidats: Novices et professionnels en politique, éd. PUF): la complexité des procédures législatives au niveau national, obscures même à ceux qui ont déjà exercé des responsabilités politiques locales, offre un avantage concurrentiel décisif à ceux qui, comme les assistants parlementaires, n’ont que des connaissances et une expérience politique à bien des égards limitées, mais sont capables de se mouvoir avec aisance dans les subtiles arcanes de l’Assemblée.
Accroître le champ de la représentation non partisane dans les assemblées législatives
Comme l’avait prévu Max Weber, la démocratie représentative suppose l’existence de partis, les individus les plus brillants eux-mêmes ne pouvant espérer exercer seuls une influence décisive sur la vie parlementaire. L’ensemble des représentants doivent participer collectivement à la formation du gouvernement du jour – ou s’y opposer – et la discipline de parti est nécessaire pour éviter le parasitisme et la démagogie. Pour autant, il serait sain et fécond que l’engagement partisan ne soit pas l’unique voie d’accès aux fonctions électives. Si nous voulons davantage de représentants de la «société civile» au sein du Parlement – des citoyens venant de l’enseignement ou du secteur de la santé, des travailleurs sociaux, des administrateurs publics ou privés, des ingénieurs ou des ouvriers ayant une expérience de l’industrie, des agriculteurs, etc. – aménager des voies d’accès à la politique électorale extérieures aux partis politiques est clairement un prérequis. En offrant à des candidats non encartés la possibilité de concourir pour l’obtention d’un mandat législatif, on pourrait considérablement améliorer la représentativité de l’Assemblée nationale, ainsi enrichie d’élus qui, sans renoncer à leurs activités originelles, acceptent de mettre – pour un temps plus ou moins long mais, c’est un point essentiel, un temps limité – leurs compétences et leur expérience au service de l’intérêt public.
Dans certains pays, comme le Portugal et l’Italie, les députés indépendants sont regroupés pour pouvoir faire entendre leur différence, bénéficier d’aides à la recherche et se voir confier des tâches parlementaires. Sur la base d’un tel modèle, il serait également possible et souhaitable de leur aménager un accès aux fonds de campagne et aux ressources dont disposent aujourd’hui les seuls partis.
Quels que soient les moyens – quotas, sièges réservés, financements alternatifs, etc. – pour y parvenir, si l’on veut distinguer la démocratie de l’oligarchie élue, il paraît nécessaire d’élargir l’éventail des personnes qui peuvent être candidates à un mandat électif et d’ouvrir des voies d’accès au corps législatif indépendantes des partis.
La dévolution de nos législatures
Il est courant de loger les assemblées législatives démocratiques dans la capitale d’une nation, bien qu’il n’y ait aucune nécessité théorique ou pratique à cela. Les capitales nationales étant généralement des lieux extrêmement privilégiés sur le plan économique, social et culturel, l’exigence d’égalité et de solidarité sociale pourrait suggérer de les déplacer géographiquement. Même si cela s’avère difficile voire impossible, il convient de se demander si les ministères doivent tous être situés dans la capitale, s’il est logique et même s’il est sain que le pouvoir exécutif soit à proximité immédiate du pouvoir législatif.
En fait, la plupart des ministères pourraient probablement être déconcentrés de manière à faciliter leur dispersion géographique et, par conséquent, offrir aux citoyens vivant loin de la capitale une meilleure perception de leur gouvernement national et de son action. Même si les débats et les votes au sein des assemblées législatives, comme certaines formes de travail en commission, peuvent encore exiger que les représentants, les conseillers et les fonctionnaires se réunissent dans un même lieu, l’assemblée législative nationale, une grande partie du travail des élus pourrait être effectuée à distance.
L’idée d’Alexander Guerrero de créer une multitude d’organes législatifs à thème unique – dont les membres seraient choisis au hasard, comme il le préconise, ou élus – souffre d’ignorer les besoins de coordination entre les débats et les décisions législatives dans les différents domaines. Des questions essentielles comme la politique étrangère et le commerce international, le développement industriel et l’environnement, le budget et les services publics sont évidemment intimement liées et ne peuvent donc être traitées indépendamment. Néanmoins, l’idée de désagréger et de décentraliser les gouvernements nationaux mérite d’être examinée. Cela pourrait contribuer à atténuer le sentiment de déconnexion que les périphéries nationales éprouvent souvent par rapport à leurs centres, à briser les bulles intellectuelles et émotionnelles créées par la concentration du pouvoir politique, culturel et économique dans les capitales nationales et à concrétiser l’idée que le gouvernement démocratique est fait par et pour les personnes de toutes les classes sociales, de tous les milieux et de toutes les cultures, plutôt que par une élite privilégiée au nom de tous les autres.
Réduction de la semaine de travail
Au sein d’une démocratie, s’engager dans l’action politique prend du temps. Dès lors, ceux et celles contraints de gagner leur vie ou de s’occuper des autres, en particulier de leurs proches, ont peu de chances de pouvoir se former et s’informer pleinement, et moins encore de s’investir dans l’exercice de responsabilités. Il est donc peu probable qu’ils et surtout elles puissent acquérir l’expérience, les relations et la confiance sans lesquelles la motivation indispensable pour se lancer l’aventure électorale restera illusoire. Fort heureusement, les récentes expérimentations sur la semaine de travail de quatre jours (sans modification de salaire) montrent des résultats positifs pour la productivité économique, à la plus grande satisfaction des employés comme des employeurs. Réalisées dans le secteur privé comme dans la sphère publique, ces expériences pourraient être prolongées par une révision du modèle actuel de répartition des heures de travail des élus, dans l’intérêt de l’égalité démocratique et de la participation de tous à la vie de la cité.
L’héritage de gouvernements non-démocratiques – la longue ombre portée du passé sur le présent – a formaté l’opinion sur la nature de l’activité politique comme sur ceux qui s’y consacrent: des privilégiés, voire des paresseux, voire des prévaricateurs. Au contraire du travail productif, l’utilité de l’action des responsables politiques est contestée, sous-estimée, ou même niée. Caricaturale et globalement erronée, cette vision persistante a conduit à priver les élus de droits accordés aux travailleurs des secteurs public et privé. On note toutefois, aux Royaume-Uni notamment, des efforts pour réparer cette injustice et prévenir ses conséquences délétères. Les députés de la Chambre des communes – l’équivalent de notre Assemblée nationale – ont insisté sur le fait que l’égalité des sexes et la démocratie exigent que le Parlement, en tant que lieu de travail, fournisse aux femmes enceintes et allaitantes les facilités accordées dans les entreprises ou les administrations; que des services de garde d’enfants soient disponibles; que les heures de travail soient aménagées. Bref, que soit prise en compte la nouvelle réalité: les députés ne sont plus, ou plus seulement, des mâles hétérosexuels disposant d’épouses fidèles assignées à résidence pour s’occuper à plein temps des enfants. Mais s’il est important d’adapter les coutumes, les bâtiments et la localisation de nos assemblées législatives pour les rendre plus inclusives, égalitaires et démocratiques, il n’est pas moins essentiel d’adapter notre façon de concevoir le travail, rémunéré ou non, afin de créer les conditions favorables à l’exercice serein d’une politique démocratique.
Conclusion
Nos politiques, et les sociétés qui les sous-tendent, sont très imparfaitement démocratiques. Cela ne devrait pas nous surprendre au vu de la difficulté que nous éprouvons à nous considérer les uns les autres comme des pairs, malgré les différences de sexe et de genre, de couleur de peau, de classe, d’appartenance ethnique et de religion, de niveau d’éducation et de réussite professionnelle. Ce profond décalage entre les promesses d’égalité démocratique et la réalité familière des schémas bien ancrés de privilèges, de négligence, de richesse et de pauvreté, d’inclusion et d’exclusion, crée les conditions d’une «crise de légitimation», pour reprendre l’heureuse expression du philosophe allemand Jürgen Habermas. La résolution de cette crise pourrait, si nous sommes imaginatifs et déterminés, conduire à un approfondissement et à un élargissement de notre compréhension de la démocratie et de notre capacité à la pratiquer. Les suggestions esquissées ici visent à rendre cette éventualité plus probable. Elles illustrent la manière dont nous pourrions utiliser les idéaux de la démocratie pour répondre à la colère, au désespoir et à l’impuissance engendrés par la persistance des formes de pouvoir et d’autorité que le gouvernement démocratique était censé avoir remplacées. Même si ce ne sont que des pistes de réflexion, elles ouvrent quelques-unes des nombreuses voies conduisant à une société plus réellement démocratique, que nous pouvons et devons emprunter.
Annabelle Lever est professeure de philosophie politique à Sciences Po Paris et chercheuse permanente au Cevipof. Ses recherches et publications portent sur la démocratie, l’éthique et politique publique, la vie privée, l’égalité et la sécurité....
Pas encore abonné(e) ?
Voir nos offresLa suite est reservée aux abonné(e)s
Déjà abonné(e) ? connectez-vous !