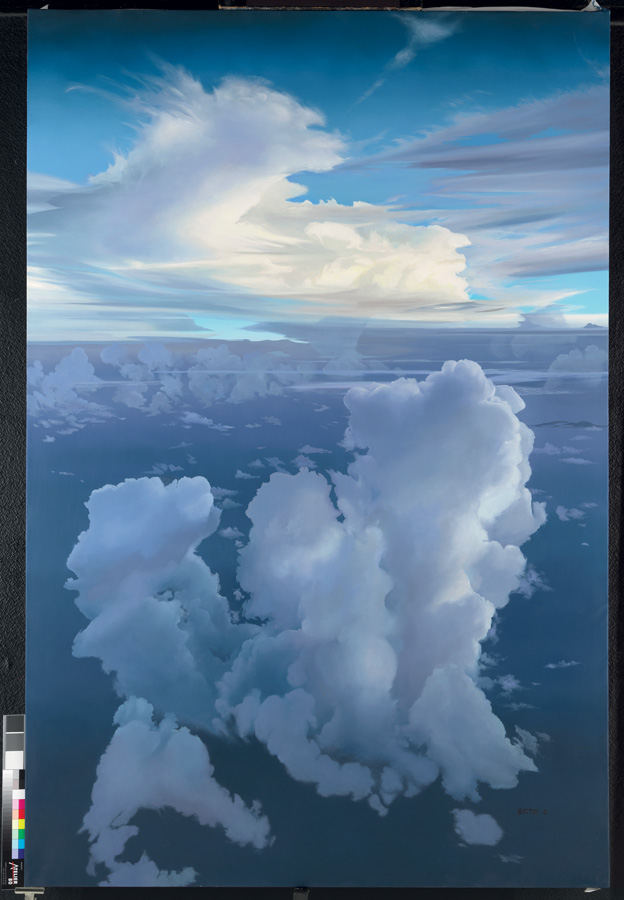Plusieurs pays du continent ont rompu avec la France au cours des dernières années. Ce rejet n’est peut-être pas irréversible. D’autant que les alternatives chinoise ou russe inquiètent sur place.
C’est l’histoire d’un nom qui porte la poisse. Le 30 septembre 2022, à Ouagadougou, ils ne sont que 300 soldats burkinabè à se révolter contre le régime militaire du colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, jugé trop mou dans la lutte contre les groupes armés terroristes (GAT). Le putsch du capitaine Ibrahim Traoré a du mal à prendre dans la troupe. Mais le lendemain, 1er octobre, coup de génie. Les putschistes font courir le bruit sur les réseaux sociaux que le président Damiba est protégé par Emmanuel Macron, qui l’aurait mis à l’abri dans un camp militaire à la périphérie de la capitale du Burkina Faso. L’information est fausse, mais le nom du président français électrise la rue. Aussitôt, des centaines de jeunes Burkinabè anti-Macron manifestent leur soutien aux putschistes. Le lendemain, le colonel Damiba s’enfuit au Togo. Le putsch est consommé. Les noms France et Macron sont devenus si toxiques qu’il a suffi de colporter une rumeur de manipulation française pour faire tomber un régime.
Pour la France d’Emmanuel Macron, la dégringolade au Sahel a été aussi rapide qu’un coucher de soleil sur le fleuve Niger. En février 2013, le chef de l’État français de l’époque, François Hollande, est acclamé à Bamako et Tombouctou. Ses militaires de l’opération Serval viennent de stopper une offensive des GAT sur Bamako et de reconquérir le nord du Mali, avec l’aide d’un contingent tchadien. Mais en mai 2021, les putschistes du colonel Assimi Goïta font le constat que les 4000 soldats français qui combattent dans le nord de leur pays depuis huit ans ne sont pas parvenus à anéantir les GAT. Au revoir la France. Le Mali fait venir les mercenaires du groupe russe Wagner. Le Mali en 2021, le Burkina Faso en 2022, le Niger en 2023… En deux ans, les trois pays du Sahel central basculent dans le camp de Vladimir Poutine. La France est rejetée au point que la détestation de la politique d’Emmanuel Macron est devenue source de légitimité – la seule, à vrai dire – pour les trois juntes qui unissent leurs forces dans une nouvelle Alliance des États du Sahel (AES).
En deux ans,
les trois pays
du Sahel central
basculent dans le camp
de Vladimir Poutine.
Pourquoi un tel rejet? De 2013 à 2021, l’état-major des armées françaises a été grisé par le succès initial de Serval dans le nord du Mali et a cru, à tort, que 4000 soldats suffiraient pour venir à bout des GAT dans un territoire grand comme l’Europe. Pendant ces huit années, le fossé n’a cessé de grandir entre l’objectif assigné et les moyens mis en œuvre, de plus en plus limités par la réduction du budget de l’armée française. À la différence des Russes avec Wagner ou des Turcs avec Sadat, les Français n’ont pas voulu envoyer sur le terrain des sociétés militaires privées (SMP), qui auraient pu appuyer leurs soldats. Ces SMP, elles existent. Pour preuve, la société Agemira d’Olivier Bazin, dont les drones ont causé de sérieuses pertes dans les rangs des rebelles du M23, en 2023, dans l’est de la RDC. Elles offrent aussi quelques avantages: elles utilisent du matériel rustique et bon marché, elles n’hésitent pas à entrer dans la guerre informationnelle (fake news, etc.) avec les Russes. Mais depuis la tentative de coup d’État menée en 1995 aux Comores par des mercenaires français, le Parlement a voté en avril 2003 une loi contre le mercenariat et, en juin 2006, un tribunal a condamné à cinq ans de prison avec sursis Bob Denard, qui fut impliqué dans de nombreux putschs en Afrique. À Paris, les SMP ont mauvaise presse et, au Mali, l’état-major français n’en a pas voulu. Il s’est enfermé dans le mythe d’une armée capable d’offrir au Sahel un tout-État sécuritaire.
Longtemps,
les présidents français,
y compris Emmanuel
Macron, se sont pensés
en surplomb de leurs
partenaires africains.
Le rejet de la France n’est pas seulement dû à cet échec tactique. Il est plus profond, il est politique. Longtemps, les présidents français de la Ve République, y compris Emmanuel Macron, se sont pensés en surplomb de leurs partenaires africains. En juillet 2007, à Dakar, Nicolas Sarkozy déclare que «le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire». Cette petite phrase, c’est le Hiroshima des relations franco-africaines. Près de vingt ans après, l’effet de souffle se fait encore sentir. C’est à partir de cette date que les élites ouest-africaines perdent confiance dans la France. Témoin l’historienne Adame Ba Konaré, l’épouse de l’ex-président malien Alpha Oumar Konaré, qui publie, en 2008, chez la Découverte Petit Précis de remise à niveau sur l’histoire africaine à l’usage de Nicolas Sarkozy. Témoin le PASTEF, le parti de l’opposant sénégalais Ousmane Sonko, qui gagne petit à petit les voix de toute la jeunesse dakaroise en dénonçant le néocolonialisme de la France. À la présidentielle de 2019, il arrive troisième avec 15 % des suffrages. À partir de 2021, il appelle ses partisans à descendre dans la rue pour protester contre la corruption de l’équipe du président Macky Sall et contre la collusion de la France avec ce régime. En 2024, après une large victoire électorale – 54 % des voix dès le premier tour –, il porte Bassirou Diomaye Faye à la présidence du Sénégal et décide de fermer la base militaire française de Dakar.
Ce rejet de la France en Afrique, Emmanuel Macron le pressent dès son arrivée au pouvoir, en mai 2017. Et pourtant, c’est plus fort que lui, le nouveau président français multiplie, lui aussi, les «maladresses vexatoires», comme disent les députés Gérard Fuchs (MoDem) et Michèle Tabarot (LR) dans leur rapport d’information parlementaire de novembre 2023. En novembre 2017, le jeune chef d’État encore trentenaire engage un dialogue sans tabou avec les étudiants de l’université de Ouagadougou, mais il gâche tout en sortant une mauvaise blague sur son homologue burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, qui s’est absenté trois minutes de l’amphithéâtre. «Ah, il a dû aller réparer la clim», plaisante-t-il. «Aurait-il fait une telle saillie à propos d’un chef d’État européen ou asiatique?» demandent aussitôt plusieurs éditorialistes africains. En mars 2023, rebelote. À Kinshasa, Emmanuel Macron n’hésite pas à humilier en public son hôte congolais, Félix Tshisekedi, en lui disant, alors que les rebelles et l’armée rwandaise envahissent son pays: «Vous n’êtes pas capable de restaurer la souveraineté de votre pays, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative, et il ne faut pas chercher de coupables à l’extérieur.» Tout récemment encore, en janvier 2025, il tance plusieurs chefs d’État sahéliens qui «ont oublié de dire merci» à la France.
Au-delà de ces grosses bourdes, qui trahissent un sentiment de supériorité et des réminiscences de Françafrique, Emmanuel Macron tente tout de même un aggiornamento. À partir de 2017, il se lance dans un «agenda transformationnel» pour modifier l’image de la France sur le continent. Sur le terrain culturel, il rompt avec la politique de François Hollande, son prédécesseur, qui refusait obstinément la restitution des œuvres d’art à l’Afrique au nom du principe que les biens entreposés dans les musées français seraient «inaliénables et insaisissables». En novembre 2018, après avoir lu le rapport de l’écrivain sénégalais Felwine Sarr et de l’historienne française Bénédicte Savoy, il ordonne la restitution d’un certain nombre de pièces pillées au XIXe siècle, notamment au Bénin. Sur le terrain mémoriel, il fait ouvrir toutes les archives secret-défense à des commissions d’historiens qui publient deux rapports clés, le premier, en 2021, sur le rôle de la France avant et pendant le génocide de 1994 au Rwanda; le second, en 2025, sur les crimes français au Cameroun entre 1945 et 1971.
Au Tchad, Emmanuel Macron
a été confronté à son plus
grand défi stratégique
en Afrique. Il a perdu à cause
d’une attitude incohérente
et contre-intuitive.
Mais malgré tous ces efforts pour «tisser davantage de liens avec les sociétés civiles africaines et mettre à distance le legs de la Françafrique», les sénateurs français Ronan Le Gleut (LR), Marie-Arlette Carlotti (PS) et François Bonneau (Centristes) constatent, dans leur rapport de janvier 2025, qu’Emmanuel Macron ne parvient pas à améliorer l’image de la France sur le continent africain. En effet, il se heurte rapidement, disent-ils, «à la prégnance des questions sécuritaires et militaires» et «aux offensives de concurrents stratégiques de la France, en particulier la Russie». De ce point de vue, le fiasco français au Tchad est emblématique. En avril 2021, coup de tonnerre. Le président Idriss Déby, vieil allié de Paris, meurt sur le champ de bataille. Mahamat Idriss Déby, l’un de ses fils, lui succède en dehors de tout cadre constitutionnel. Emmanuel Macron vient personnellement à N’Djamena pour installer cette succession dynastique, dans l’espoir que le nouveau dirigeant acceptera en retour de maintenir tout ou partie des 1000 soldats français positionnés au Tchad. Pour le président français, l’échec est cuisant. Non seulement il se montre incohérent sur le plan politique – il condamne les coups d’État au Mali et au Niger, mais soutient le coup de force constitutionnel au Tchad –, mais il n’en retire aucun bénéfice stratégique. Au contraire, en novembre 2024, après soixante-cinq ans de présence quasi ininterrompue, tous les militaires français sont chassés du Tchad, où ils sont en train d’être remplacés par des SMP équipées de drones venus des Émirats arabes unis et de Turquie. Au Tchad, Emmanuel Macron a été confronté à son plus grand défi stratégique en Afrique. Il a perdu à cause d’une attitude incohérente et contre-intuitive.
Ce rejet est-il irréversible? Pas sûr. En Afrique, Emmanuel Macron n’est pas (encore) mort. La France n’est pas rejetée par toutes les sociétés africaines, loin de là. Dans les pays anglophones et lusophones, où elle n’a laissé historiquement aucune souvenir colonial, la France est bien cotée. En décembre 2024, la visite du président nigérian Bola Tinubu s’est soldée par l’implantation à venir d’une cinquième banque nigériane à Paris, qui est devenu récemment le premier hub d’affaires du géant africain (plus de 230 millions d’habitants) en Europe. En janvier 2025, à l’issue du séjour à Paris du chef de l’État angolais João Lourenço, les entreprises des deux pays ont annoncé la création d’une chambre de commerce bilatérale. En 2026, sans doute avant l’été, aura lieu un sommet Afrique-France au Kenya, où Emmanuel Macron soigne sa relation avec le président William Ruto. Une telle rencontre dans l’ancien joyau de l’empire colonial britannique… Tout un symbole.
La France n’est pas rejetée
par toutes les sociétés
africaines, loin de là.
Dans les pays anglophones
et lusophones,
elle est bien cotée.
Dans la sphère francophone, la France garde des relations étroites avec plusieurs pays de l’océan Indien, à commencer par Madagascar. Dans la région des Grands Lacs, la diplomatie française parvient, non sans mal, à garder la confiance des deux principaux belligérants, le Rwandais Paul Kagamé et le Congolais Félix Tshisekedi. Kigali vient de rompre ses relations diplomatiques avec la Belgique, mais pas avec la France. Dans le golfe de Guinée, la position de la France n’a pas été impactée par le putsch qui a renversé en août 2023 la famille Bongo, qui occupait le pouvoir depuis 1967, avec d’abord Omar, le père, jusqu’en 2009 puis Ali, le fils. Au contraire, les relations franco-gabonaises sont plus fluides avec le général Oligui Nguema que du temps d’Ali Bongo. Et les Chinois, qui espéraient pouvoir installer une base militaire au Gabon pour leurs bâtiments de guerre – au grand dam des Américains –, doivent y renoncer. «C’est une discussion que j’ai eue avec le président Xi lorsque je me suis rendu en Chine (en septembre 2024), mais le Gabon pour l’instant n’a pas besoin de base», vient de déclarer le nouvel homme fort du pays, qui souhaite le maintien d’un petit contingent militaire français à Libreville.
Surtout, en Afrique centrale, la clameur de la rue n’est pas antifrançaise. Ces dernières semaines, pendant la campagne pour la présidentielle gabonaise, la France n’a pas été un sujet de polémique. Même chose au Cameroun, où les futurs candidats à la présidentielle d’octobre 2025 ne font pas de la France un point de clivage. L’ancienne puissance coloniale est-elle responsable de la pauvreté de beaucoup d’Africains? Ce n’est pas l’avis du sénateur Marc Ona Essangui, une figure de la société civile gabonaise: «Les Africains doivent prendre leurs responsabilités pour se débarrasser des facteurs de sous-développement. C’est ce débat qu’on doit avoir, pas le débat de bouc-émissaire ou d’accusation de tel ou tel qui voudrait appauvrir l’Afrique. Et ce qui est contradictoire dans le discours de certains Africains, c’est de penser que voilà, on va chasser la France, on va chasser le colon, et puis on va se jeter dans les bras de la Russie, de la Chine et d’autres. Mais on ne peut pas être aussi incohérent. Si nous voulons nous débarrasser de tout ce qui est à l’origine de notre sous-développement, il faut tenir un discours qui engage les Africains à se développer eux-mêmes.»
En réalité, à part en République centrafricaine, où le régime du président Faustin-Archange Touadera a basculé dans le camp de la Russie après le retrait des militaires français de l’opération Sangaris, en octobre 2016, c’est seulement en Afrique de l’Ouest que le rejet de la France se manifeste. Et pas partout. En Côte d’Ivoire, où l’on votera en octobre prochain, le président Alassane Ouattara et son principal adversaire, Tidjane Thiam, du PDCI, sont profrançais et antirusses. Les deux seules figures prorusses de l’échiquier ivoirien sont l’ancien président Laurent Gbagbo, inéligible pour l’instant, et l’ex-Premier ministre Guillaume Soro, qui vit en exil au Niger. En Guinée Conakry, le général putschiste Mamadi Doumbouya entretient certes de bonnes relations avec les frères d’armes qui ont pris le pouvoir au Sahel. En janvier 2025, une centaine de véhicules militaires en provenance de Russie ont transité par le port de Conakry pour venir renforcer l’armée malienne à Bamako. Mais le numéro un guinéen ne veut pas basculer dans le camp de Moscou. «Avec Sékou Touré, depuis les années 1960 jusqu’en 1985, nous avons connu l’alignement sur la Russie, l’isolement et la pauvreté. Nous ne voulons pas revivre cela», confie un ministre guinéen. En octobre 2024, à sa demande, le pays a réintégré l’Organisation internationale de la Francophonie, l’OIF, qui est l’un des outils du rayonnement de la France dans le monde.
Les régimes militaires
qui ont expulsé la France
sont tenus par des juntes
de plus en plus isolées
dans leur propre pays.
C’est donc au Sahel que Paris est vraiment en perte de vitesse. Cependant, les régimes militaires qui ont expulsé la France sont tenus par des juntes de plus en plus isolées dans leur propre pays. Ainsi au Mali, le très autoritaire général Assimi Goïta s’est brouillé avec le Haut Conseil islamique de l’imam Dicko – qui s’est exilé à Alger – et avec le M5 de l’ex-Premier ministre Choguel Maïga, tandis que les incessantes coupures d’électricité font monter la colère des habitants de Bamako. Au Niger, le général Abdourahamane Tiani n’est pas à l’abri d’un coup d’État interne ou d’un mouvement de ras-le-bol de la population face aux pénuries de carburant. Récemment, en plein conseil des ministres, le Premier ministre Ali Lamine Zeine a montré deux photos au chef de la junte. Sur la première, il y avait une manifestation proputschistes à Niamey, juste après le coup d’État de juillet 2023. Sur la seconde, on voyait une autre manifestation proputschistes, mais un an plus tard. Il y avait trois fois moins de monde… Au Burkina Faso, le fantasque capitaine Ibrahim Traoré, qui s’est mis à dos toute la société civile depuis l’arrestation de l’avocat Guy-Hervé Kam, est en train d’installer un climat de terreur.
La raison d’être officielle de ces dictatures militaires est la lutte contre les djihadistes. Mais les mercenaires russes venus en renfort de l’armée malienne n’arrivent pas à éradiquer les GAT et les indépendantistes touaregs, qui sont maintenant équipés eux aussi de drones. En juillet 2024, militaires maliens et supplétifs russes ont essuyé une défaite cuisante à Tinzaouatène, non loin de la frontière algérienne, où 74 mercenaires russes ont été tués et deux capturés. Depuis neuf mois, Moscou tente de négocier en vain leur libération. Les rebelles ont-ils été aidés par les services secrets ukrainiens? C’est ce que laisse entendre Kiev… Un raid touareg sur une grande ville du nord du Mali, comme Kidal, Gao ou Tombouctou, ou un raid sur Niamey, la capitale du Niger, n’est plus à exclure. En Syrie, le lâchage du régime de Bachar al-Asad par Moscou, en décembre 2024, montre à tous ces régimes prorusses que la garantie sécuritaire de Vladimir Poutine n’est peut-être pas aussi solide que le croient certains. Après l’euphorie prorusse des années 2021 à 2024, attention à l’effet gueule de bois. Entre Poutine et Macron, le match n’est pas encore terminé....
Pas encore abonné(e) ?
Voir nos offresLa suite est reservée aux abonné(e)s
Déjà abonné(e) ? connectez-vous !