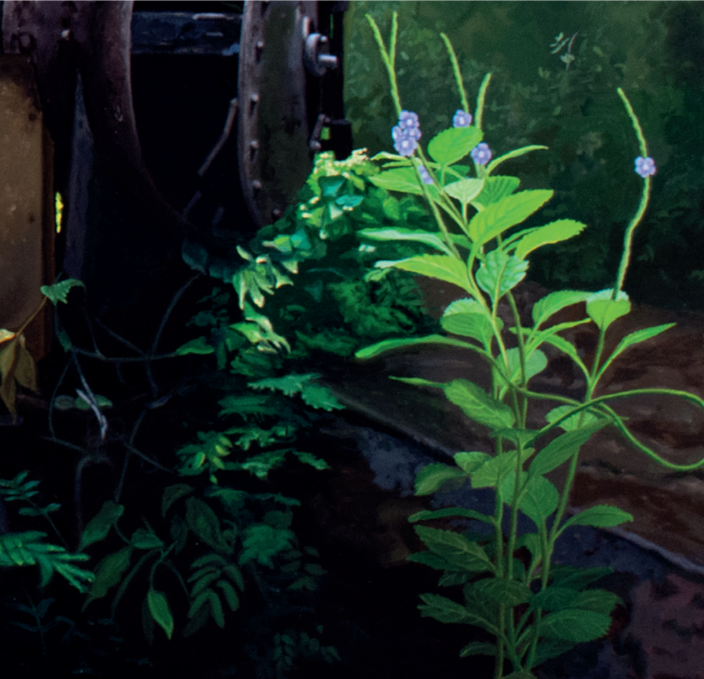Il est temps d’inventer des nouvelles façons de parler d’écologie, d’imaginer les termes qui permettront de dépasser les débats clivants.
Dix ans après les Accords de Paris sur le climat, en 2015, on sait que l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5° C ne pourra pas être atteint. Alors que cela devrait nous inciter collectivement à agir plus, plus vite, plus fort, nous assistons à un recul sur de nombreux fronts : remise en question de la parole scientifique, montée du climatoscepticisme, coupes budgétaires, renoncement à des mesures essentielles à la préservation de la biodiversité… À l’échelle des États, des entreprises et des citoyens, c’est une dépriorisation des sujets liés au climat et à la biodiversité qui semble s’être enclenchée. Et derrière ce sujet d’agenda, pointe une forme de lassitude et même d’exaspération d’une partie des citoyens nourrie par certains médias et politiques. Une tendance à l’écophobie émerge alimentée par le terme d’écologie punitive.
Un terme qui confisque le débat et agit comme un repoussoir en associant l’écologie à un discours et des actions liberticides. Quand l’écologie dans sa dimension scientifique devrait faire consensus, elle redevient un sujet clivant sur le plan politique. Mais alors, si la polarisation est à l’œuvre et que le débat est confisqué, faut-il encore débattre ?
Il ne s’agit évidemment pas de renoncer à y croire, la vérité scientifique est établie. Pas non plus de renoncer à convaincre, le point de bascule culturel n’est pas encore atteint. Et surtout pas de renoncer à agir, l’action de tous et de chacun est plus que jamais nécessaire. Il s’agit plutôt d’inventer des nouvelles façons de parler d’écologie, d’imaginer les termes qui permettront de dépasser les débats autour de l’écologie punitive, et sans doute aussi de diversifier les relais et porte-paroles de ces discours. Essayons un instant de nous projeter dans un monde où on parlerait d’écologie différemment.
*
Pour une écologie positive.
Ne soyons pas naïfs, mais donnons des raisons d’espérer pour donner envie d’agir. Le discours écologique verse depuis longtemps dans le catastrophisme. Évidemment, les événements climatiques extrêmes que nous voyons se multiplier lui donnent indubitablement raison. Ce discours a été utile pour faire comprendre les risques, utile pour alerter le grand public, utile pour fédérer les militants. Mais n’a-t-il pas atteint aujourd’hui ses limites ? Si on cherche à développer une écologie positive auprès du plus grand nombre, il est sans doute temps de rééquilibrer le discours en parlant aussi des réussites de l’écologie, des solutions et des bonnes nouvelles. Et il y en a, aussi bien au niveau des États, que des entreprises ou des citoyens :
– au premier trimestre 2025, la Chine pour la première fois a diminué de 1,6 % ses émissions de CO2 ;
– en quelques années, l’association CEC a engagé des centaines d’entreprises de tous les secteurs d’activité dans une trajectoire ambitieuse de questionnement de leurs modèles d’affaires en cohérence avec les limites planétaires ;
– dans le dernier baromètre de la consommation responsable de l’Ademe, 8 Français sur 10 estiment qu’il faut revoir nos modes de vie.
*
Pour une écologie des abondances.
Nous savons tous que la solution est dans la sobriété. La difficulté c’est que notre cerveau nous pousse à prendre plus que ce dont nous avons besoin, à confondre désir et besoin. Et la sobriété ne fait rêver que ceux qui n’ont jamais manqué de rien. Pour les autres, elle sent le rationnement. Alors pour valoriser la sobriété rien de mieux sans doute que de valoriser les nouvelles abondances auxquelles elle nous renvoie et dont parle Dominique Méda. La marche, la musique, la lecture, mais aussi l’émerveillement, l’empathie, la solidarité, l’engagement, les interactions sociales, les relations affectives, la préservation des biens communs naturels sont des activités à consommer sans modération puisqu’elles peuvent nous rendre heureux sans abimer les écosystèmes auxquels nous appartenons.
*
Pour une écologie juste.
Les enjeux écologiques et sociaux sont indissociables. Si 50 % des émissions de CO2 à l’échelle mondiale sont le fait des 10 % les plus riches de la planète, cela nous ramène à des sujets d’équité autour de l’effort nécessaire. Nous Français faisons partie de ces 10 % les plus riches à l’échelle de la planète. Et à l’échelle française on retrouve un écart important en fonction des revenus : l’empreinte carbone des 10 % les plus riches est quatre fois supérieure à celle des 10 % les plus pauvres. La question pourrait donc se résumer à « quels renoncements pour atteindre un niveau d’émissions compatible avec les limites planétaires ? » Surtout « qui doit renoncer ? » Tout le monde, au nom de l’égalité, ou ceux qui émettent le plus, au nom de l’équité ? La question écologique ne pourra pas faire l’impasse sur la question sociale du juste effort demandé à chacun et de l’exemple que nous aurons envie de suivre. Celui de Katy Perry qui se paye une virée dans l’espace ou celui de Dua Lipa, star mondiale aux 88 millions de followers, filmée en allant prendre son train à la Gare du Nord ?
*
Pour une écologie des libertés.
Si, dès qu’elle remet un tant soit peu en question nos modes de vie, l’écologie est perçue comme liberticide, ce sont sans doute d’autres libertés, des libertés supérieures qu’il faut désormais promouvoir. La liberté de vivre dans un environnement qui ne soit pas pollué, qui ne soit pas nocif, la liberté des peuples à accéder à des ressources naturelles et essentielles sans en priver leurs voisins ou les générations futures, la liberté des espèces à exister, la liberté des écosystèmes les plus précieux à être sanctuarisés au bénéfice de tous, etc.
*
Pour une écologie implicite.
« Pensons-y toujours, n’en parlons jamais », disait Gambetta à propos de l’Alsace et de la Lorraine. Sans aller jusqu’à cette radicalité, on peut imaginer qu’on gagne en efficacité en restant concentré sur l’objectif sans chercher systématiquement à prêcher. Il suffit pour s’en convaincre de constater que quand on présente un plat végétarien au restaurant d’entreprise le succès est mitigé, alors que si on présente régulièrement un plat du jour sans viande sans le faire remarquer, en restant dans l’implicite, la part de ceux qui le choisissent sera beaucoup plus élevée et donc l’impact plus important.
Dans un tout autre domaine mais qui touche aussi nos modes de vie, Blablacar est sans doute une des entreprises qui a le plus contribué à la décarbonation des transports depuis sa création. Mais ce n’est pas sur ce levier qu’elle a construit son discours et son succès. Sa réussite est liée à son nom qui met en avant le bénéfice de convivialité du covoiturage et à son modèle qui permet de partager le prix du voyage. Deux leviers sans rapport direct avec l’écologie mais qui ont des effets bien réels en matière d’écologie.
*
Et pourquoi pas aussi une « égologie » ?
Il faut peut-être aussi envisager que le sens du collectif ne soit pas un moteur pour tout le monde et qu’une approche plus égocentrée dans laquelle agir pour le climat c’est agir pour soi puisse devenir un levier. Une écologie qui motive par des cobénéfices individuels tels que la santé, la sécurité ou le pouvoir d’achat : je mange moins de viande pour ma santé et pour mon pouvoir d’achat, j’utilise les mobilités douces pour être en forme et ne plus avoir à payer pour une voiture que j’utilise moins de 5 % du temps… Si je ne le fais pas pour « sauver la planète », pour le bien commun, si je ne le fais pas pour les générations futures, mais si je le fais pour moi, mon porte-monnaie ou mon « summer body », et bien pourquoi pas… si je le fais ?
La question n’est donc pas de savoir s’il faut encore parler d’écologie, mais plutôt de savoir comment en parler désormais. Nous venons d’évoquer différentes clés pour régénérer le discours sur l’écologie. Toutes n’ont pas la même valeur, toutes ne s’adressent pas aux mêmes personnes, toutes n’ont pas la même efficacité dans la transition. Et il en existe bien d’autres encore. Mais ce qui est certain c’est qu’il faut tenter d’autres perspectives, d’autres mots, d’autres leviers et d’autres porte-paroles. Et cela en s’appuyant sur la majorité silencieuse, celle que n’écoutent pas suffisamment les responsables politiques. Celle qui – selon l’étude de Nature Climate Change sur 130 000 personnes dans 125 pays – regroupe 89 % de citoyens (dont 85 % en France) qui souhaitent que leur gouvernement fasse davantage contre le changement climatique. À quand la révolution citoyenne ?
Olivier Bailloux est directeur du planning stratégique et de la RSE de l’agence de publicité Saatchi & Saatchi....
Il est temps d’inventer des nouvelles façons de parler d’écologie, d’imaginer les termes qui permettront de dépasser les débats clivants. Dix ans après les Accords de Paris sur le climat, en 2015, on sait que l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5° C ne pourra pas être atteint. Alors que cela devrait nous inciter collectivement à agir plus, plus vite, plus fort, nous assistons à un recul sur de nombreux fronts : remise en question de la parole scientifique, montée du climatoscepticisme, coupes budgétaires, renoncement à des mesures essentielles à la préservation de la biodiversité… À l’échelle des États, des entreprises et des citoyens, c’est une dépriorisation des sujets liés au climat et à la biodiversité qui semble s’être enclenchée. Et derrière ce sujet d’agenda, pointe une forme de lassitude et même d’exaspération d’une partie des citoyens nourrie par certains médias et politiques. Une tendance à l’écophobie émerge alimentée par le terme d’écologie punitive. Un terme qui confisque le débat et agit comme un repoussoir en associant l’écologie à un discours et des actions liberticides. Quand l’écologie dans sa dimension scientifique devrait faire consensus, elle redevient un sujet clivant sur le plan politique. Mais alors, si la polarisation est à l’œuvre et que le débat est confisqué, faut-il encore débattre ? Il ne s’agit évidemment pas de renoncer à y croire, la vérité scientifique est établie. Pas non plus de renoncer à convaincre, le point de bascule culturel n’est pas encore atteint. Et surtout pas de renoncer à agir, l’action de…