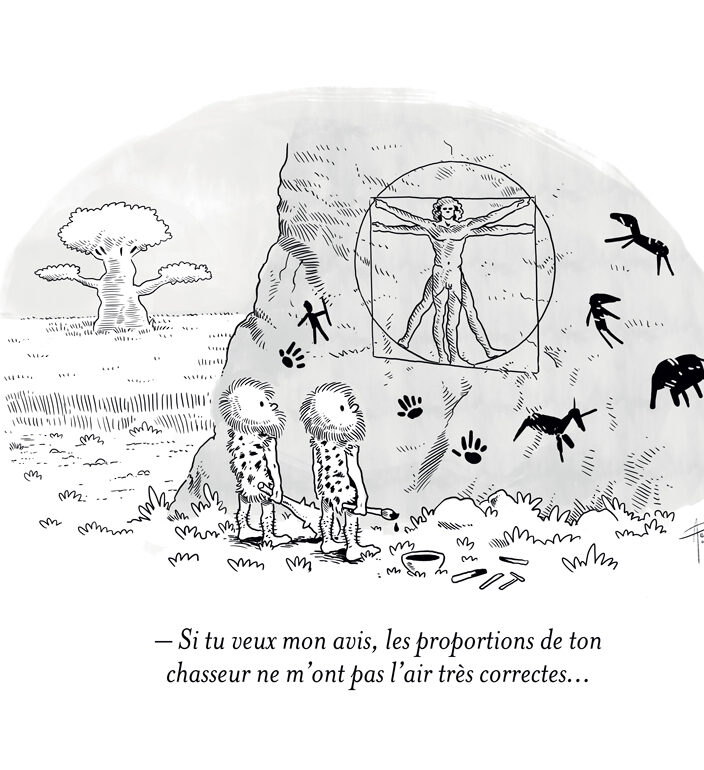Historiquement bourreaux, les pays du Nord se sont longtemps vus comme des sauveurs mais sont en train de devenir des victimes. Il est impératif d’accepter de renégocier les termes du contrat écologique mondial.
La forêt a longtemps été considérée dans les négociations climatiques comme une variable d’ajustement : un puits de carbone parmi d’autres, un réservoir statistique utile pour alimenter les modèles climatiques du GIEC. Elle était mesurée, comptabilisée, parfois monétisée, mais réfléchie comme une ressource passive, captive, commune à tous, au même titre que les océans. Depuis quelques années, la situation évolue et devient plus complexe. Le réchauffement créant l’urgence, la rareté créant le désir, la forêt s’impose désormais comme un sujet non seulement écologique mais aussi politique, économique et symbolique à part entière.
La complexité de la situation prend ses racines dans une réalité géographique indiscutable : 60 % des forêts primaires restantes sur Terre sont concentrées sur moins de 8 % des terres émergées, principalement au Brésil, en République démocratique du Congo et en Indonésie. Une concentration qui pousse sur le devant de la scène environnementale des États qui n’en avaient pas l’habitude et leur donne un levier diplomatique inédit. La bascule dans l’équilibre des pouvoirs devient flagrante lors du G7 d’août 2019 : à Emmanuel Macron qui propose une aide d’urgence pour faire face aux incendies qui ravagent l’Amazonie – qu’il considère comme un actif naturel mondial –, Jair Bolsonaro, alors président du Brésil, oppose une fin de non-recevoir, lui suggérant plutôt d’utiliser ces capitaux pour reboiser son propre continent. Cet échange pose les bases d’une nouvelle donne : celle où les hectares de forêt deviennent un outil de pouvoir dans le dialogue Nord/Sud.
Avant de poursuivre, il semble utile d’ouvrir une parenthèse sur une dimension toute autre de la forêt. Au-delà de ses propriétés écologiques, elle constitue un repère culturel de nombreuses civilisations. Présente dans nos récits et nos mythes, théâtre de nos peurs et de nos espoirs, elle incarne à la fois le refuge et le danger, l’espace où l’on laisse son enfant pour qu’il vive, comme Mowgli, ou meure, comme le Petit Poucet. On respecte la forêt comme on respecte nos anciens : parce qu’elle nous précède, parce qu’elle nous dépasse. Parce que contrairement à ce que nous aimons penser, la nature ne nous appartient pas, c’est nous qui appartenons à la nature.
Mais alors que les forêts primaires fondent comme neige au soleil sous l’effet d’incendies ou de la déforestation, une question se pose : à qui revient la responsabilité de les protéger ? Leur poids dans la lutte contre le réchauffement climatique mondial est évident, leur valeur écologique, universelle. Néanmoins, leur gestion relève juridiquement des quelques États où elles sont implantées. Cette tension entre intérêt commun et souveraineté nationale est au cœur de nombreuses incompréhensions. Comment répartir équitablement les efforts, les coûts, les bénéfices ? À force de vouloir mutualiser les fonctions écologiques de la forêt sans redéfinir les modalités de sa gouvernance, on entretient un malentendu fondamental : celui d’un bien global régi par des logiques purement nationales.
Depuis 2019, de nouvelles tensions sont apparues entre l’Union européenne et plusieurs pays concernés. Récidivant sa volonté d’intervenir à marche forcée dans la protection des forêts, Bruxelles adopte en 2023 un règlement interdisant l’importation de produits liés à la déforestation. Elle aligne ainsi sa politique commerciale sur ses objectifs climatiques et se présente comme pionnière de la lutte contre la déforestation, ce qui permet à ses membres de s’autocongratuler. Dans les pays du Sud, ce règlement est perçu comme un chantage environnemental. À Kinshasa ou Jakarta, la réaction est cinglante : l’UE refuse leur cacao, leur huile de palme ou leur bois au nom de l’écologie, et fait peser le poids de la transformation sur leurs paysans. Certains dirigeants africains évoquent ouvertement la relance de concessions d’abattage si l’Occident ne paie pas le coût d’une conservation durable. Le rapport de force a changé de sens. La forêt devient une arme défensive autant qu’un bien commun.
L’exemple du parc de Yasuni, en Équateur, illustre cette tension dans une saga qui aurait pu s’intituler « Forêt contre forage » :
– Saison 1 « L’Échec du politique » : en 2007, Rafael Correa, alors président de la République d’Équateur, propose de renoncer à exploiter les ressources pétrolières de cette réserve forestière unique de biodiversité, en échange d’un soutien financier international équivalent à 50 % de la valeur du pétrole potentiellement exploitable. L’appel reste lettre morte puisque moins de 1 % des fonds sont récoltés.
– Saison 2 « Drill, Baby, Drill » : en 2013, Rafael Correa autorise l’exploitation des ressources du parc et les forages commencent en 2016. Un collectif d’Équatoriens continue à se battre pour Yasuni en demandant la tenue d’un référendum populaire, qu’ils mettront dix ans à obtenir.
– Saison 3 « La Voix du peuple » : en 2023, contre toute attente, un référendum national consacre la volonté populaire puisque 59 % des Équatoriens votent l’interdiction d’exploiter le pétrole dans le parc. Un succès pour l’humain et la nature, qui attend encore de devenir réalité puisque l’exploitation n’a pas pris fin.
Yasuni n’est pas une anecdote, c’est un concentré de dilemmes globaux. Souveraineté contre protectionnisme. Actif monétisable contre bien commun inestimable. Court terme contre long terme. En moins de deux décennies, l’Équateur sera passé par toutes les postures du triangle dramatique de Karpman – tour à tour victime, bourreau, puis sauveur. Une structure souvent visible dans les rapports entre États du Nord et pays riches en forêt primaire : historiquement bourreaux, les premiers se sont longtemps vus comme des sauveurs, mais sont en train de devenir des victimes. Alterner les rôles ne résoudra rien, il est impératif de sortir du triangle et d’accepter de renégocier les termes du contrat écologique mondial.
Malheureusement les initiatives récentes, qu’elles viennent des pays du Sud ou du Nord, sont encore porteuses de visions fragmentées, ne prenant pas en compte toutes les dimensions de la forêt, et largement empreintes des dynamiques insatisfaisantes du passé. Pour autant, la multiplication de ces initiatives témoigne d’un intérêt sans précédent, qui préfigure le rôle géopolitique qu’est en train de prendre la forêt. Il n’est d’ailleurs pas anodin que les pays riches en forêt primaire aient proposé en 2023 la création d’un « Opep des forêts », avec pour objectif d’augmenter la transparence et l’efficacité des actions de protection, mais aussi de peser sur le prix du carbone. Si cette idée d’un cartel forestier a pu susciter la méfiance voire les railleries, c’est que certains acteurs sous-estiment encore l’ampleur des enjeux liés aux actifs naturels.
Les initiatives que l’on observe traduisent trois visions :
1) Une vision comptable, fondée sur la capacité des forêts à générer des flux financiers via les crédits carbone. L’Indonésie a mis en place une stratégie d’émission d’obligations vertes reposant sur le mécanisme REDD+ (Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts), qui permet au pays de transformer ses actions de réduction de la déforestation en crédits carbone. L’Indonésie cherche ainsi à s’affranchir de son modèle économique traditionnel fortement destructeur de forêts – en raison notamment de la prévalence du soja et de l’huile de palme – pour mettre en place une économie forestière durable, valorisant la forêt comme un actif économique. Au-delà de l’aspect financier, l’enjeu pour Jakarta est aussi celui de la souveraineté. L’Indonésie exige que la certification REDD+ soit validée par ses propres agences avant toute reconnaissance internationale, garantissant ainsi un contrôle national sur la gestion et la certification des projets forestiers. Cette exigence permet au pays de contribuer aux objectifs climatiques mondiaux tout en conservant son pouvoir décisionnel.
2) Une vision territoriale, plus proche de l’approche traditionnelle d’aide au développement des pays du Nord, qui se concrétise à travers l’initiative lancée lors du One Forest Summit organisé par la France et le Gabon en mars 2023. En parallèle de l’adoption de la Déclaration de Libreville, un fonds de 100 millions d’euros a été créé pour rémunérer la conservation des forêts tropicales. Bien que modeste, cette initiative a deux avantages majeurs : elle permet de placer l’Afrique centrale sur le radar des investisseurs climatiques et elle inscrit le rôle des communautés locales au cœur de la gouvernance. Ce mécanisme privilégie un financement flexible et décentralisé, ancré dans les réalités locales, tout en maintenant un contrôle sur les résultats en matière de préservation des forêts. La difficulté principale réside dans le passage à l’échelle d’un tel mécanisme.
3) Une vision patrimoniale, incarnée par le projet de Tropical Forest Forever Facility (TFFF), le mécanisme financier proposé par le Brésil qui devrait être lancé lors de la COP 30 de Belém. Il a pour objectif de lever des fonds publics et privés, qui seront placés pour permettre de rémunérer les pays qui conservent leurs forêts. Si cette approche permet de mobiliser d’importants flux financiers en faveur des forêts, elle risque cependant d’éloigner les investisseurs des réalités locales en leur donnant à voir un actif forestier international consolidé. Or, c’est lorsque la finance perd contact avec la réalité qu’elle commet ses plus grandes erreurs. Pour cette raison, il est essentiel de repenser la gouvernance du projet en renforçant la participation des acteurs locaux. De nombreux acteurs de la société civile, comme la Global Forest Coalition, plaident pour une gouvernance inclusive qui garantit une participation active des communautés locales et des peuples autochtones, afin d’assurer que la conservation des forêts soit alignée avec leurs droits et leurs besoins.
Ces trois visions se confrontent dans un contexte où la forêt, loin d’être une simple ressource, devient un enjeu géopolitique majeur. L’urgence est de les articuler, non de les opposer. Car la forêt n’est pas un produit de luxe à négocier à la criée : c’est la matrice de notre stabilité climatique, de notre diversité biologique et une composante fondamentale de notre humanité. Tant que nous n’aurons pas placé la justice sociale et la transparence au cœur de la gouvernance, tant que les pays du Nord et Sud alterneront les rôles du triangle de Karpman sans s’en affranchir, la géopolitique verte restera un jeu à somme négative. Il est temps, à Belém comme à Paris ou à Kinshasa, de construire un multilatéralisme forestier qui protège les arbres et les peuples qui vivent à leur ombre.
Dirigeant d’entreprise engagé dans la transition écologique, Philippe Zaouati a contribué au développement de la finance durable, notamment au sein du groupe d’experts de la Commission européenne. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont quatre romans....
Historiquement bourreaux, les pays du Nord se sont longtemps vus comme des sauveurs mais sont en train de devenir des victimes. Il est impératif d’accepter de renégocier les termes du contrat écologique mondial. La forêt a longtemps été considérée dans les négociations climatiques comme une variable d’ajustement : un puits de carbone parmi d’autres, un réservoir statistique utile pour alimenter les modèles climatiques du GIEC. Elle était mesurée, comptabilisée, parfois monétisée, mais réfléchie comme une ressource passive, captive, commune à tous, au même titre que les océans. Depuis quelques années, la situation évolue et devient plus complexe. Le réchauffement créant l’urgence, la rareté créant le désir, la forêt s’impose désormais comme un sujet non seulement écologique mais aussi politique, économique et symbolique à part entière. La complexité de la situation prend ses racines dans une réalité géographique indiscutable : 60 % des forêts primaires restantes sur Terre sont concentrées sur moins de 8 % des terres émergées, principalement au Brésil, en République démocratique du Congo et en Indonésie. Une concentration qui pousse sur le devant de la scène environnementale des États qui n’en avaient pas l’habitude et leur donne un levier diplomatique inédit. La bascule dans l’équilibre des pouvoirs devient flagrante lors du G7 d’août 2019 : à Emmanuel Macron qui propose une aide d’urgence pour faire face aux incendies qui ravagent l’Amazonie – qu’il considère comme un actif naturel mondial –, Jair Bolsonaro, alors président du Brésil, oppose une fin de non-recevoir, lui suggérant plutôt d’utiliser ces capitaux pour reboiser son propre continent. Cet…