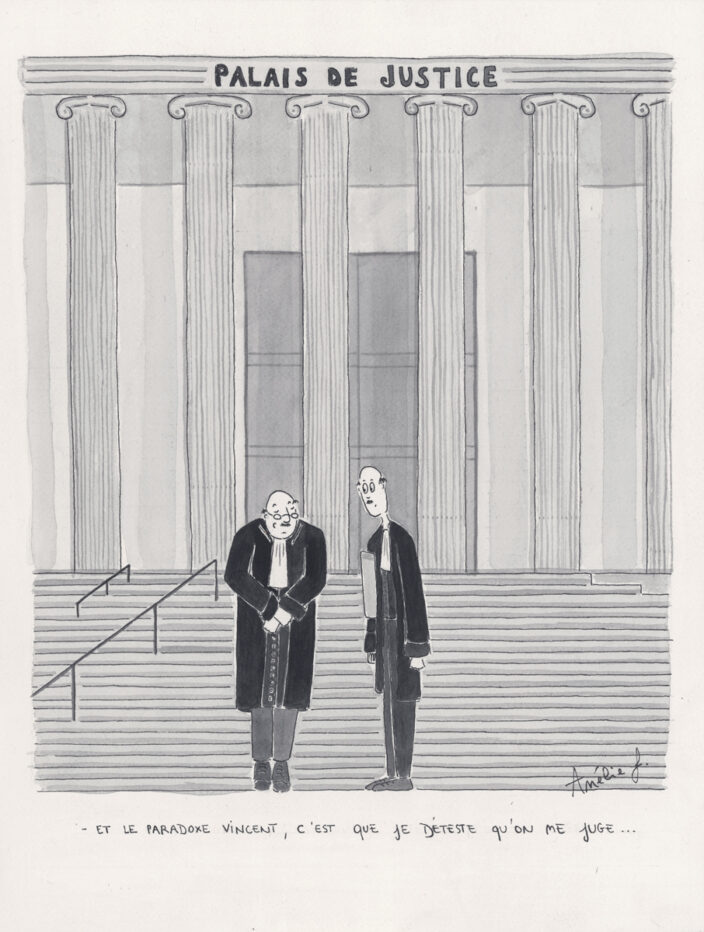S’ils ne sont pas les premiers à avoir codifié le droit, les Romains en ont pourtant introduit des notions fondamentales – telles que la confiance et l’équité – qui irriguent encore la pratique judiciaire contemporaine.
Quand on aborde la question de la justice, on ne peut pas ignorer Rome. Si les philosophes de l’Antiquité sont grecs, les juristes sont romains. Grâce à une littérature juridique abondante et à la volonté de certains empereurs, notamment Théodose puis Justinien, le droit romain s’est imposé dans les esprits. Redécouvert à partir de l’an mil, il s’est répandu dans la majeure partie de l’Europe et quelque 150 pays dans le monde s’appuient désormais sur ces fondations. Juriste et historien, titulaire depuis 2018 de la chaire « Droit, culture et société de la Rome antique » au Collège de France, Dario Mantovani est un spécialiste reconnu de cette matière. Pour lui, le droit romain implique « une sorte de vision idéale de “qu’est-ce que l’humain ?” et “qu’est-ce que la vie en société ?” » D’où cette vocation universaliste, en ce sens que les principes étudiés peuvent être convoqués dans n’importe quel environnement. Pour autant, il n’ignore pas la tension entre histoire et anthropologie.
Quelle influence a l’histoire du droit sur les systèmes juridiques actuels ?
À mes yeux, l’histoire du droit – c’est-à-dire l’étude du passé juridique – est avant tout la science du possible. Elle nous apprend à mesurer l’espace de liberté dont nous disposons pour modifier le droit en tant que technique du juste et de l’équitable.
Contrairement aux sciences dites « dures », comme la physique ou la chimie, qui s’attachent à comprendre des phénomènes préexistants, le droit n’est pas une donnée de la nature : il est une construction humaine, un artefact né de l’imagination et de la pratique sociale, qui s’est façonné au fil des siècles. C’est pourquoi l’étude du passé permet de discerner ce qui, dans la technique juridique, est contingent et donc réformable, et ce qui, au contraire, est structurel, et résiste aux changements. En d’autres termes, l’histoire nous révèle à la fois les limites et les potentialités de la pensée juridique. Voilà pourquoi on peut l’appeler la science du possible.
Le droit commence-t-il à Rome ?
Les Romains ne furent pas les premiers à pratiquer le droit. Toute société a besoin d’un ensemble de règles destinées à distinguer les comportements permis de ceux qui sont interdits. D’où l’adage : « Là où il y a une société, il y a du droit. » Mais, même s’il y a eu plusieurs expériences auparavant, dans d’autres régions, le droit de la Rome antique occupe une place particulière en raison de son influence persistante : aujourd’hui encore, on dénombre quelque 150 pays dont le système juridique puise ses racines, plus ou moins profondément, dans le droit romain. Notamment pour ce qui concerne le droit privé.
Comment les Romains ont-ils bâti ce système juridique ?
En plusieurs étapes : au Ve siècle av. J.-C., il y eut une première codification – la loi des Douze Tables – dont la vigueur demeura presque intacte jusqu’à la fin de l’Empire. Ensuite, à partir du IIIe siècle av. J.-C., il y eut un développement majeur, sous l’impulsion d’une nouvelle classe de juristes : des intellectuels qui façonnèrent un système étendu et cohérent, axé sur un ensemble de valeurs. Ils sont les véritables inventeurs de la technique du droit à laquelle je faisais référence plus haut. Leur réflexion se présentait surtout sous la forme de réponses données aux particuliers et aux magistrats qui les consultaient. Ce corpus juridique, d’abord oral, fut diffusé par une littérature, à partir du IIe siècle av. J.-C. et jusque vers 300 apr. J.-C. : cinq siècles de réflexion et d’écriture du droit ! Mais il n’y avait pas que les juristes : ils développaient des règles et des valeurs établies par le peuple romain (sous forme de lois), par le Sénat et aussi – ce point est très important – par les magistrats, en particulier par le préteur. Les préteurs étaient chargés de l’administration de la justice. Chaque année, ils publiaient un édit dans lequel ils énonçaient les actions – c’est-à-dire les recours judiciaires – par lesquels ils accordaient une protection aux situations qu’ils jugeaient dignes de l’être. Cet instrument technique permettait à la fois de mieux encadrer les litiges et de créer un véritable « État de droit », avec des règles établies et connues. Mais comme un nouvel édit était affiché chaque année, cela offrait aussi l’occasion de faire évoluer la protection judiciaire en fonction des besoins sociaux émergents.
Comment cette production juridique a-t-elle abouti à la rédaction d’un code au sens où nous l’entendons aujourd’hui ?
Au VIe siècle apr. J.-C., l’empereur Justinien fit rassembler trois grandes anthologies : le Code, qui contient les lois impériales ; les Institutes, manuel destiné aux étudiants ; et le Digeste, qui réunit les écrits des juristes. Plus tard, un quatrième ouvrage vint s’y ajouter : les Novelles (les « lois nouvelles »). Ce corpus de droit civil fut redécouvert vers l’an mil, dans le nord de l’Italie, et cette redécouverte eut deux conséquences majeures : d’une part, la naissance de l’université, avec le modèle de Bologne qui s’imposa – institution dont l’origine est directement liée à l’intérêt pour l’étude du droit romain – et, d’autre part, la diffusion du droit romain dans toute l’Europe continentale. Le droit romain devint ainsi le droit commun de l’Europe médiévale et moderne, jusqu’à l’adoption du Code Napoléon et du Code civil allemand, tous deux fondés sur cette pensée juridique romaine, et qui, à leur tour, ont fécondé de nombreux systèmes juridiques dans le monde entier.
Quand les Romains commencèrent à élaborer leur système juridique, était-ce pour tendre vers un idéal de justice ou seulement pour permettre à la société de fonctionner ?
Cette question me rappelle le cri de douleur de Simone Weil dans L’enracinement : « Si l’on admire l’Empire romain, pourquoi en vouloir à l’Allemagne qui essaie de le reconstituer, sur un territoire plus vaste, avec des méthodes presque identiques ? ». Le parallèle n’est pas entièrement acceptable, mais attribuer à l’Empire romain l’idée de justice implique de sous-estimer certaines réalités, notamment l’écrasement des populations qui se sont opposées à l’expansion de Rome. Il faut d’ailleurs faire la distinction entre droit public et droit privé. Le droit public, c’est le rapport entre les gouvernés et les gouvernants. Le droit privé, c’est le rapport entre les particuliers. Il y a un troisième volet, le droit international, qui traite des rapports entre les États. Ce que nous avons hérité des Romains, c’est principalement le droit privé. L’idée de base qui le guide est que chacun a droit à une portion des ressources, à la condition que cela n’entraîne pas de dommages pour les autres ; que les rapports entre particuliers doivent être gouvernés par le principe de la parole donnée, ce qu’ils appellent la fides, la confiance, la bonne foi. C’est comme si, derrière ces principes, se profilait une sorte de vision idéale de ce qu’est l’être humain et de ce qu’est la vie en société. C’est pourquoi le droit romain a une certaine vocation universaliste. Il tend à bâtir une sorte de société idéale et le droit privé romain est la technique au service de cette vision de la justice.
L’empire romain ne peut pourtant pas être qualifié de société idéale…
À l’évidence, non. Certaines caractéristiques sont, pour nous, inacceptables : par exemple, le fait que les prisonniers de guerre deviennent esclaves des vainqueurs, et que leurs enfants le restent. À côté de ces phénomènes que nous jugeons aujourd’hui à juste titre aberrants, dans le système juridique romain il y a pourtant une rationalité fascinante, presque sidérante. Tous les phénomènes sociaux sont catégorisés (par exemple l’achat ou la location) et, une fois classés, des effets précis leur sont attribués. Nous avons hérité de cette technique mais nous avons évacué certains aspects qui dépendaient de la configuration des pouvoirs dans une société antique. Est-ce qu’on peut admirer l’Empire romain ? On ne peut pas juger le passé avec nos critères, mais il est impossible de l’étudier en fermant les yeux et en oubliant nos valeurs.
Sans entrer dans un débat religieux, pourrait-on voir dans le droit romain une sorte de codification juridique des Dix Commandements de la Bible ?
C’est ce qu’affirmait, dans l’Antiquité tardive, un auteur qui soutenait que le Décalogue avait déjà tout dit, cherchant à montrer la continuité entre l’Ancien Testament et le droit romain, à une époque de christianisation. L’identité de l’auteur et ses intentions restent discutés, mais cela témoigne de l’influence durable du droit romain, conçu comme l’aboutissement de la civilisation. On l’utilisait même pour légitimer la religion : preuve de son importance.
Cela montre aussi que l’arrêt de la publication d’ouvrages de juristes vers 300 apr. J.-C. ne signifia pas la fin de leur influence : leurs écrits étaient devenus des classiques, lus et copiés jusqu’à Justinien, qui en fit l’anthologie du Digeste. Paradoxalement, ce droit issu de sociétés païennes continua d’être jugé valable dans des contextes très différents. Voilà le mystère du droit romain : il a survécu à la christianisation, à la chute de l’Empire, au passage du Moyen Âge à l’époque moderne, jusqu’aux codifications napoléonienne et allemande, et, d’une certaine manière, aussi au-delà d’elles et grâce à elles.
Au début, la diffusion du droit romain tient-elle à l’impérialisme romain ou à sa puissance philosophique et juridique intrinsèque ?
L’impérialisme fut sans doute un facteur décisif de diffusion. Mais il convient de rappeler que l’Empire romain était avant tout un réseau de cités jouissant de degrés variés d’autonomie. Certaines étaient totalement soumises, tandis que d’autres conservaient leur souveraineté, y compris leur autonomie législative et judiciaire, leurs relations avec Rome étant régies par des traités. Partout, toutefois, le fonctionnement de l’économie profitait à des mécanismes institutionnels de l’administration de la justice romaine, qui assuraient un cadre de prévisibilité et de communication entre les différents ordres juridiques. La diffusion du droit reposait donc aussi sur ces avantages partagés. Enfin, en 212, la citoyenneté romaine fut accordée à tous les habitants de l’Empire : à partir de ce moment, de l’Espagne jusqu’à la Perse, tous appliquèrent le droit romain.
Le droit romain était-il toujours diffusé en latin ?
En dépit de l’acculturation, le latin est toujours resté la langue du droit. Les textes étaient étudiés en latin même si on parlait grec. Le droit était un véhicule d’ascension sociale : on pouvait devenir avocat ou fonctionnaire de l’empire. Mon équipe a retrouvé une copie du code de Théodose, de 438, qui est une anthologie des lois impériales. Sur ce papyrus, les lois rédigées en latin sont entourées de commentaires en grec. Cela montre une appropriation d’une autre langue, d’une autre culture, et aussi une continuité du droit même dans l’Antiquité tardive : le commentateur explique que, pour comprendre cette loi impériale, il faut lire les juristes romains précedents.
Quand démarre le processus médiéval et moderne d’universalisation du droit romain ?
Autour de l’an mil ; et la ville où j’ai fait mes études, Pavie, y a joué un rôle important. Il s’ensuit l’essor des universités, entre 1100 et 1400, d’abord à Bologne, et à Paris également. Le succès du droit romain y était tel que son enseignement a été interdit en 1219 dans cette université, où les études de théologie étaient reines. L’Église, en particulier le pape Honorius III, y voyait un risque : l’attrait pour le droit pouvait détourner les jeunes clercs de la vocation religieuse. C’est pour cette raison que la faculté de droit vint s’épanouir à Orléans.
Au Moyen Âge, le contexte politique était favorable à l’universalisation du droit romain. Adopter le droit romain codifié par Justinien permettait de légitimer le pouvoir des empereurs du Saint-Empire romain, qui se pensaient comme les successeurs des Romains. En France, les rois cherchaient à s’affranchir du pouvoir de l’empereur, mais affirmaient vouloir néanmoins appliquer le droit romain, non en raison de l’Empire, mais par l’empire de la raison. Même si, en France, il connut un destin particulier, les signes de sa diffusion sont multiples. Par exemple, en 1376, est publié un livre qui deviendra célèbre, Le Songe du Vergier, qui met en scène un clerc et un chevalier qui discutent en particulier du rôle des femmes dans la succession au trône de France et des rapports entre la monarchie et la papauté. Rédigé à l’intention de Charles V, ce texte utilise le droit romain pour résoudre ces problèmes. Cet ouvrage montre que le Corpus Iuris Civilis de Justinien est devenu une partie fondamentale de l’imaginaire européen, non seulement du droit privé mais aussi du droit public.
Comment le droit romain s’est-il imposé dans le monde médiéval et moderne ?
Si le droit romain a pu s’imposer universellement, c’est bien parce qu’il est sous-tendu par une vision anthropologique qui dépasse largement la place de l’homme dans la société antique. Le droit romain est pourtant, d’une certaine manière, victime de sa propre gloire. Pour pouvoir l’appliquer de nouveau, il a fallu lui ôter ses signes distinctifs, le rendre plus abstrait afin de lui permettre de devenir universel. Pour réagir à cette neutralisation historique, en 1508, Guillaume Budé – le futur promoteur du Collège de France – rédigea un commentaire sur le Digeste de Justinien, en cherchant à le replacer dans son contexte d’origine. Le mérite de l’humanisme fut de comprendre le droit romain comme un produit de l’Antiquité, et donc de l’interpréter comme tel. Cette perspective de mise en contexte historique nourrit encore aujourd’hui une grande partie des études d’histoire du droit dans le monde.
Vous avez évoqué l’autonomie dont disposaient certaines cités conquises par les Romains. Peut-on déceler dans le droit romain les prémices d’un droit international ?
L’usage des traités était très répandu dès l’origine. Le premier traité que nous connaissions, conclu entre Rome et Carthage, date de 508 av. J.-C., au début de la République. Même en dehors des traités, des principes coutumiers se sont imposés, notamment celui de l’inviolabilité des ambassadeurs. En 282 av. J.-C., Tarente, une cité d’origine grecque des Pouilles, s’inquiétait de l’expansion de Rome vers le sud de l’Italie. Rome envoya alors des ambassadeurs. Ceux-ci furent méprisés et leur toge souillée. Rome considéra que cela constituait une cause suffisante pour déclarer la guerre à Tarente. L’entorse au principe de l’inviolabilité des ambassadeurs ne fut pas, bien sûr, la cause unique de cette guerre, mais elle permit de la justifier. Les hommes ont toujours eu besoin de légitimer leurs actions – mais aussi de s’appuyer sur des règles pour ne pas trop s’égarer.
En creux s’esquissait déjà la notion de guerre juste. Cicéron théorisa que les adversaires devaient être des États, c’est-à-dire dotés d’un pouvoir légitime ; qu’il devait exister une cause, comme un tort manifeste dont on n’aurait pu obtenir réparation ; et que le but ne devait pas être la conquête, mais le rétablissement de la paix. Il fallait en outre que la guerre fût déclarée en bonne et due forme, tâche qui incombait au collège des fétiaux, lequel suivait un rituel précis.
Le droit international s’appuie sur des principes, mais comment les faire respecter ?
Dans l’Empire romain, c’était évidemment à Rome qu’incombait la charge d’assurer l’application de ces principes. Rome, directement ou en désignant comme arbitre une cité tierce, a souvent œuvré comme médiateur entre des villes en conflit. Cela se passait plutôt bien parce qu’il existait un cadre de pouvoir, et les Romains disaient aux parties : soit vous vous mettez d’accord, soit nous intervenons. Ce modèle romain du droit international est éclairant : au-delà des principes énoncés et des institutions déjà existantes, même à l’état embryonnaire, il met en évidence un paradigme essentiel : le droit international ne fonctionne que s’il existe un pouvoir capable de l’imposer par la force militaire.
Cela signifie-t-il qu’une superpuissance, comme l’était Rome, est nécessaire pour appuyer les principes et garantir la paix ?
Cette superpuissance était-elle vraiment un instrument de paix ? Ou n’était-elle qu’un mécanisme d’exploitation ? Sans doute les deux à la fois. Les Nations unies ont été créées, en principe, pour régler collectivement les conflits interétatiques. Mais, en pratique, le mécanisme de décision dépend des grandes puissances. Bien sûr, même s’ils ne sont pas appliqués – ou seulement partiellement – les principes ont sans aucun doute leur importance : ils aident à penser ce que le monde devrait être. Ce n’est pas rien. Mais ont-ils réellement le pouvoir de le transformer ? Je n’ai pas la réponse. Voyons un exemple concret, tiré du droit privé romain. Le principe de base – en plus de la fides, cette confiance dans la parole donnée – était l’équité (aequitas). Nos sociétés sont-elles équitables ? Il faut d’abord rappeler que l’équité n’est pas l’égalité : c’est la prise en compte des différences. Si, dans une relation entre deux personnes, la situation de départ est différente, l’équité veut qu’elle soit préservée ; il ne faut pas égaliser.
Ainsi, en droit maritime, existe le principe de « l’avarie commune » : lorsqu’un navire transportant des marchandises est en danger et que le capitaine jette une partie de la cargaison pour sauver le reste, les propriétaires dont les marchandises ont été sacrifiées doivent être indemnisés par ceux dont les biens ont été conservés, ainsi que par l’armateur lui-même, car sans ce délestage, son navire aurait sans doute sombré. C’est un principe qui met en lumière l’interdépendance de nos relations : si l’on a été épargné, c’est grâce au sacrifice des autres. L’équité peut sans doute remplir une fonction d’orientation, voire d’éducation. On l’a évoquée au moment de la pandémie de coronavirus : ceux qui étaient en première ligne devaient être récompensés par ceux qui avaient été moins touchés. En clair, l’équité n’est pas un principe abstrait de bienveillance : l’atteindre exige la prise en compte d’un critère arithmétique fondé sur l’asymétrie des situations initiales, mais aussi sur l’interdépendance qui tisse les liens sociaux.
Parler de droits de la nature, ou de droit naturel, a-t-il un sens ?
Pour les Anciens, la nature – la physis – est une force interne qui façonne tous les êtres vivants, mais de manière différente : elle donne aux plantes la capacité de se nourrir, aux animaux la sensibilité et la faculté de se reproduire, mais c’est seulement aux humains qu’elle confère la raison, c’est-à-dire la capacité à réfléchir sur leur propre comportement. Eux seuls ont accès à cette sphère que l’on appelle la sphère de la vertu, disposant du pouvoir de distinguer entre le bien et le mal, entre ce qui est juste et ce qui ne l’est pas. C’est là, pour les Anciens, le domaine du droit, qui constitue l’outil technique de la justice. En insistant sur l’aspect naturel du droit, on en arrive donc paradoxalement à une posture anthropocentrée, posture aujourd’hui remise en cause.
Pour autant, peut-on nier l’incidence du droit sur la nature ?
Le droit façonne-t-il la nature ? Oui, évidemment, si l’on comprend la nature non pas comme force interne qui façonne les êtres vivants, mais comme notre environnement. Les règles qui déterminent la manière dont nous nous rapportons à celui-ci ont un impact considérable, pour le meilleur comme pour le pire. Prenons un seul exemple. Pour les Anciens, quiconque pouvait s’emparer de biens tels que l’air, l’eau des fleuves ou d’autres ressources qu’ils considéraient comme communes. Chacun pouvait les exploiter sans limite, n’ayant pas conscience de leur finitude. Aujourd’hui, l’évidence des périls pesant sur notre écosystème a conduit à légiférer pour introduire précisément des limites. Dans ce sens, on a ressuscité la catégorie des biens communs, mais cette fois pour les soustraire à toute appropriation individuelle indiscriminée, au nom même de leur appartenance à tous.
C’est là un usage de la technique juridique, inspiré de catégories antiques mais orienté vers de nouvelles finalités. C’est précisément en confrontant l’orientation antique et l’approche contemporaine de concepts apparemment identiques que l’on mesure combien ces propositions tendent à remettre en cause le système capitaliste lui-même, dont le développement a été indubitablement favorisé, au XIXe siècle, par le réemploi des catégories du droit romain.
Certains veulent, du reste, donner une personnalité juridique à des fleuves, des montagnes…
C’est l’aboutissement ultime de cette perspective. Si nous voulons dépasser cette posture anthropocentrée, nombreux sont ceux qui soutiennent que il nous faut faire entrer les animaux, les plantes, les fleuves, les océans dans le droit. C’est-à-dire accorder à tous et à chacun une personnalité juridique. Cela implique que la nature aurait des droits, tandis que dans le système actuel il n’existe que des obligations à la charge des humains : ne pas polluer, ne pas tuer cruellement les animaux, etc... La première objection que l’on adresse à cette proposition est que, sur le plan pratique, si les humains peuvent eux-mêmes exercer les droits dont ils sont titulaires, il est évident que ni les animaux, ni les écosystèmes ne pourraient ester directement en justice. On peut bien leur reconnaître cette faculté théorique, mais sur le plan pratique comment la mettre en œuvre ? Il reviendrait nécessairement à des intermédiaires humains de faire valoir les intérêts de la nature. Mais, au fond, c’est déjà le cas aujourd’hui : il y a un système de protection de la nature qui passe par l’intervention d’une autorité publique ou d’associations qui s’emploient à faire respecter les devoirs imposés aux hommes envers la nature. Si la proposition de conférer des droits à la nature perdure, malgré ces difficultés pratiques, c’est parce qu’elle possède une valeur métaphorique évidente : elle invite à considérer les animaux et les écosystèmes comme des participants à part entière du monde dont nous faisons nous aussi partie. Le droit devient ainsi un moyen de communication de valeurs, au-delà de sa fonction proprement technique. En tant que juriste et historien du droit, j’observe que la notion juridique de personne est née en relation avec les êtres humains et le droit s’est construit autour de cette notion. Par conséquent, l’élargir à d’autres entités est loin d’être une opération limitée. Cela exigerait – disons, sur un plan structurel – de modifier l’ensemble de la conception du droit, ce qui est très complexe et problématique. Je reviens donc à cette idée de l’histoire du droit comme science du possible. Je ne remets pas en cause l’objectif de protéger la nature, je questionne les moyens. Le risque est qu’en employant des moyens inadaptés, on rate l’objectif. Pour moi, il convient de renforcer les obligations des humains vis-à-vis de la nature. Quand Aristote affirme que les humains sont les seuls à posséder la raison, et donc la vertu, il met le doigt sur la plaie : les humains doivent aussi se soucier des autres êtres vivants, car eux seuls disposent des moyens techniques — notamment la parole et, par conséquent, le droit avec ses concepts — pour les protéger....
Pas encore abonné(e) ?
Voir nos offresLa suite est reservée aux abonné(e)s
Déjà abonné(e) ? connectez-vous !